Thèses défendues en COMU
espo | Louvain-la-Neuve, Mons
-
 Pauline Zecchinon - Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information. Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones26 Aug26 Aug...
Pauline Zecchinon - Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information. Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones26 Aug26 Aug...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Pauline Zecchinon
soutiendra publiquement sa dissertation
Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information.
Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones
pour l'obtention du grade de Doctorat en Information et Communication
Inscription
Résumé
Jamais n’a-t-on autant pris, utilisé et publié de photographies que ces vingt dernières années, avec une omniprésence accrue dans la presse depuis l’avènement du web. Pourtant, la photographie de presse traverse une crise sans précédent. Les avancées technologiques ont bouleversé les pratiques de production, d’édition et de publication des images dans les médias d’information quotidiens, qui doivent gérer divers canaux et supports en flux quasi permanent. Cette multiplicité engendre des déséquilibres, certains aspects de la production, comme la photographie, étant moins bien pourvus en ressources. Dans ce contexte, la manière de produire et d’aborder les images en rédaction exprime à la fois des enjeux spécifiques à l’information visuelle et des transformations structurelles dans l’organisation des rédactions.
Notre recherche vise à comprendre le rôle et la valeur de l’image photographique dans les stratégies éditoriales et les processus de construction de l’information dans les rédactions des trois quotidiens belges francophones de référence (Le Soir, La Libre et L’Écho) et de deux rédactions francophones étrangères (Le Temps et Le Monde). Au-delà des processus de sélection et des stratégies éditoriales dans une rédaction donnée, c’est la place de l’image en rédaction, sa valeur informative, sa plus-value journalistique et la place du journaliste dans son traitement, tout comme la place du public en matière de réception ou de sélection, qui sont interrogés. Pour mener à bien cette recherche, nous nous appuyons sur une enquête ethnographique au sein des cinq rédactions, accompagnée d’entretiens semi-directifs avec des acteurs clés dans les processus et les stratégies d’édition des images.
Les résultats de cette recherche offrent des pistes pour améliorer l’utilisation stratégique de la photographie dans les médias, en soulignant son rôle crucial dans l’attraction des lecteurs, la transmission d’informations et la différenciation des marques. Ils montrent également que l’équilibre entre ces fonctions n’est pas encore atteint, en raison des contraintes imposées par les infomédiaires et des défis économiques, ce qui souligne l'importance de renforcer les compétences éditoriales et la culture visuelle au sein des rédactions.
Membres du jury
Prof. Olivier Standaert (UCLouvain), promoteur
Prof. Benoît Grevisse (UCLouvain), président du jury
Prof. Sébastien Fevry (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. David Domingo (Université Libre de Bruxelles), évaluateur externe
Prof. Leen d’Haenens (KULeuven), évaluatrice externeEn savoir plus Pauline Zecchinon - Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information. Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones26 Aug26 Aug...
Pauline Zecchinon - Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information. Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones26 Aug26 Aug...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Pauline Zecchinon
soutiendra publiquement sa dissertation
Rôles et valeur de la photographie dans les médias d’information.
Étude des stratégies éditoriales et des processus de production et de sélection des photographies dans cinq rédactions de quotidiens francophones
pour l'obtention du grade de Doctorat en Information et Communication
Inscription
Résumé
Jamais n’a-t-on autant pris, utilisé et publié de photographies que ces vingt dernières années, avec une omniprésence accrue dans la presse depuis l’avènement du web. Pourtant, la photographie de presse traverse une crise sans précédent. Les avancées technologiques ont bouleversé les pratiques de production, d’édition et de publication des images dans les médias d’information quotidiens, qui doivent gérer divers canaux et supports en flux quasi permanent. Cette multiplicité engendre des déséquilibres, certains aspects de la production, comme la photographie, étant moins bien pourvus en ressources. Dans ce contexte, la manière de produire et d’aborder les images en rédaction exprime à la fois des enjeux spécifiques à l’information visuelle et des transformations structurelles dans l’organisation des rédactions.
Notre recherche vise à comprendre le rôle et la valeur de l’image photographique dans les stratégies éditoriales et les processus de construction de l’information dans les rédactions des trois quotidiens belges francophones de référence (Le Soir, La Libre et L’Écho) et de deux rédactions francophones étrangères (Le Temps et Le Monde). Au-delà des processus de sélection et des stratégies éditoriales dans une rédaction donnée, c’est la place de l’image en rédaction, sa valeur informative, sa plus-value journalistique et la place du journaliste dans son traitement, tout comme la place du public en matière de réception ou de sélection, qui sont interrogés. Pour mener à bien cette recherche, nous nous appuyons sur une enquête ethnographique au sein des cinq rédactions, accompagnée d’entretiens semi-directifs avec des acteurs clés dans les processus et les stratégies d’édition des images.
Les résultats de cette recherche offrent des pistes pour améliorer l’utilisation stratégique de la photographie dans les médias, en soulignant son rôle crucial dans l’attraction des lecteurs, la transmission d’informations et la différenciation des marques. Ils montrent également que l’équilibre entre ces fonctions n’est pas encore atteint, en raison des contraintes imposées par les infomédiaires et des défis économiques, ce qui souligne l'importance de renforcer les compétences éditoriales et la culture visuelle au sein des rédactions.
Membres du jury
Prof. Olivier Standaert (UCLouvain), promoteur
Prof. Benoît Grevisse (UCLouvain), président du jury
Prof. Sébastien Fevry (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. David Domingo (Université Libre de Bruxelles), évaluateur externe
Prof. Leen d’Haenens (KULeuven), évaluatrice externe -
 Julia Bihl - Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique10 Jul10 Jul...
Julia Bihl - Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique10 Jul10 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Julia Bihl
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique”
Lien TEAMS
Résumé
Les médias, notamment à travers les dispositifs de communication mobiles et les réseaux socio-numériques, jouent un rôle crucial dans notre société contemporaine, intégrant étroitement la technologie dans notre quotidien. La maîtrise des compétences médiatiques numériques est devenue essentielle pour l'intégration sociale et économique. Cependant, la véritable émancipation sociale nécessite une littératie médiatique critique et inclusive.
Dans cette perspective, notre étude doctorale, centrée sur des élèves de troisième secondaire en Belgique francophone, combine une enquête quantitative et une enquête qualitative pour explorer les façons d’agir plus ou moins compétentes des jeunes en situation de recherche d'information et de production médiatique en contexte numérique.
La partie quantitative de l'étude constitue le volet belge d’une enquête internationale nommée « Littératie médiatique des adolescent·e·s », élaborée par un collectif de chercheur·e·s francophones dans quatre régions (Belgique francophone, Québec, Suisse romande, Normandie). Cette enquête permet de dresser un état des lieux des compétences médiatiques des jeunes à partir de leur autoévaluation, de l’évaluation concrète de tâches de recherche et de production, et de l’évaluation d’une activité de production d’un article à visée informative publié sur une plateforme en ligne.
La partie qualitative vise à comprendre les logiques d'action des jeunes pendant l'activité médiatique proposée. Elle analyse, de façon complémentaire à l’analyse quantitative, les modes d'engagement des adolescent·e·s dans l’activité et l’agir plus ou moins critique qui en résulte en situation.
Les résultats de cette recherche offrent des pistes concrètes pour poursuivre l’intégration scolaire de la littératie médiatique dans une perspective critique et encouragent la prise en compte de la diversité des modes d'engagement des adolescent·e·s afin d'adapter les dispositifs d'éducation aux médias.
Membres du jury
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur
Prof. Thibault Philipette (UCLouvain), président du jury
Prof. Eric Delamotte (Université de Rouen-Normandie), comité d’accompagnement
Prof. Barbara Fontar (Université de Rennes), évaluatrice externe
Prof. Anne Lehmans (Université de Bordeaux), évaluatrice externe
En savoir plus Julia Bihl - Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique10 Jul10 Jul...
Julia Bihl - Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique10 Jul10 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Julia Bihl
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Littératie médiatique des adolescent·e·s : Etude l’agir compétent en activité de recherche d’information et production numérique”
Lien TEAMS
Résumé
Les médias, notamment à travers les dispositifs de communication mobiles et les réseaux socio-numériques, jouent un rôle crucial dans notre société contemporaine, intégrant étroitement la technologie dans notre quotidien. La maîtrise des compétences médiatiques numériques est devenue essentielle pour l'intégration sociale et économique. Cependant, la véritable émancipation sociale nécessite une littératie médiatique critique et inclusive.
Dans cette perspective, notre étude doctorale, centrée sur des élèves de troisième secondaire en Belgique francophone, combine une enquête quantitative et une enquête qualitative pour explorer les façons d’agir plus ou moins compétentes des jeunes en situation de recherche d'information et de production médiatique en contexte numérique.
La partie quantitative de l'étude constitue le volet belge d’une enquête internationale nommée « Littératie médiatique des adolescent·e·s », élaborée par un collectif de chercheur·e·s francophones dans quatre régions (Belgique francophone, Québec, Suisse romande, Normandie). Cette enquête permet de dresser un état des lieux des compétences médiatiques des jeunes à partir de leur autoévaluation, de l’évaluation concrète de tâches de recherche et de production, et de l’évaluation d’une activité de production d’un article à visée informative publié sur une plateforme en ligne.
La partie qualitative vise à comprendre les logiques d'action des jeunes pendant l'activité médiatique proposée. Elle analyse, de façon complémentaire à l’analyse quantitative, les modes d'engagement des adolescent·e·s dans l’activité et l’agir plus ou moins critique qui en résulte en situation.
Les résultats de cette recherche offrent des pistes concrètes pour poursuivre l’intégration scolaire de la littératie médiatique dans une perspective critique et encouragent la prise en compte de la diversité des modes d'engagement des adolescent·e·s afin d'adapter les dispositifs d'éducation aux médias.
Membres du jury
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur
Prof. Thibault Philipette (UCLouvain), président du jury
Prof. Eric Delamotte (Université de Rouen-Normandie), comité d’accompagnement
Prof. Barbara Fontar (Université de Rennes), évaluatrice externe
Prof. Anne Lehmans (Université de Bordeaux), évaluatrice externe
-
 Yuliya Samofalova - Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations08 Jul08 Jul...
Yuliya Samofalova - Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations08 Jul08 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Yuliya Samofalova
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations”
Inscription
Abstract
Climate change is an urgent global issue requiring culturally relevant communication to foster sustainable practices. Despite diminished media coverage during the COVID-19 pandemic, the urgency of addressing the climate crisis remains relevant. In this study, we highlight the pivotal role of Instagram in shaping environmental discourses, emphasizing that communication effectiveness frequently depends on aligning opinion leader content with their established image and expertise.
Focusing on Instagram, one of the most popular visual social media platforms in Europe, the research examines the semiotic forms of discourses on pro-environmental efforts in the food, energy, and transport sectors as communicated by Belgian, French, and Norwegian environmental opinion leaders and opinion-leading organizations between January 2021 and March 2022. The study also evaluates how these messages are perceived by audiences in terms of obstacles to pro-environmental action and environmental values, contributing to a deeper understanding of the interplay between media content and audience attitudes.
We present an extensive corpus of Instagram posts (N=22882). Adopting a value-based approach from environmental psychology, this research draws on a mixed-method research design. We apply an automated content analysis based on a dictionary approach to select a specific corpus of posts concerning the food, energy, and transport themes. Multimodal content analysis of 2092 posts regarding the three sectors provides an overview of environmental discourses in Belgium, France, and Norway. To deeply examine how the obstacles to are communicated in the verbal and visual modes, we conduct four case studies. To examine how the obstacles, values, and narrative roles are represented in the case studies, we integrate multimodal discourse analysis and computer-assisted linguistic analysis of the posts. We combine content analysis, computer-assisted linguistic analysis, and sentiment analysis to investigate the obstacles, environmental values, and narrative roles that appeared in the comments.
By analyzing the variation in discourses shaping citizens’ beliefs and actions towards pro-environmental behavior, this research provides insights into European opinions on solutions and barriers or obstacles to climate change mitigation in the three sectors. The findings have implications for future environmental communication strategies, highlighting the need for coherent digital communication and the potential of social media to motivate pro-environmental action. Besides practical implications, this study is a valuable methodological contribution combining different computational and manual approaches to social media data. In addition, the collected corpora can be used for pedagogical implications for teaching Environmental Communication.
Résumé
Le changement climatique est un problème mondial urgent qui nécessite une communication culturellement pertinente pour encourager les pratiques durables. Malgré une couverture médiatique réduite lors de la pandémie de COVID-19, l'urgence de faire face à la crise climatique reste d'actualité. Dans cette étude, nous soulignons le rôle central d'Instagram dans la formation des discours environnementaux, en insistant sur le fait que l'efficacité de la communication dépend souvent de l'alignement du contenu des leaders d'opinion sur leur image et leur expertise.
En se concentrant sur Instagram, l'une des plateformes de médias sociaux visuels les plus populaires en Europe, la présente recherche examine les formes sémiotiques des discours sur les efforts pro-environnementaux dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, et des transports communiqués par les leaders d'opinion environnementaux belges, français et norvégiens entre janvier 2021 et mars 2022. L'étude évalue également comment ces messages sont perçus par les publics en termes d'obstacles à l'action pro-environnementale et de valeurs environnementales, contribuant ainsi à une compréhension plus approfondie de l'interaction entre le contenu des médias et les attitudes du public.
Nous présentons un vaste corpus de posts Instagram (N=22882). Adoptant une approche fondée sur les valeurs de la psychologie environnementale, cette étude s'appuie sur un modèle de recherche mixte. Nous appliquons une analyse de contenu automatisée établie sur une approche par dictionnaire pour sélectionner un corpus spécifique de messages concernant les thèmes de l'alimentation, de l'énergie, et des transports. L'analyse multimodale du contenu de 2092 messages concernant les trois secteurs donne un aperçu des discours environnementaux en Belgique, en France, et en Norvège. Afin d'examiner en profondeur la manière dont les obstacles sont communiqués dans les modes verbal et visuel, nous menons quatre études de cas. Pour examiner comment les obstacles, les valeurs, et les rôles narratifs sont représentés dans les études de cas, nous intégrons l'analyse multimodale du discours et l'analyse linguistique assistée par ordinateur pour investiguer les posts choisis. Nous combinons l'analyse du contenu, l'analyse linguistique assistée par ordinateur, et l'analyse des sentiments pour étudier les obstacles, les valeurs environnementales, et les rôles narratifs qui apparaissent dans les commentaires.
En analysant la variation des discours qui façonnent les croyances et les actions des citoyens en faveur d'un comportement pro-environnemental, cette recherche donne un aperçu des opinions européennes sur les solutions et les barrières ou obstacles à l'atténuation du changement climatique dans les trois secteurs. Les résultats ont des implications pour les futures stratégies de communication environnementale, soulignant la nécessité d'une communication numérique cohérente et le potentiel des médias sociaux pour motiver les actions pro-environnementales. Outre les implications pratiques, cette étude est une contribution méthodologique précieuse combinant différentes approches informatiques et manuelles des données des médias sociaux. En outre, les corpus collectés peuvent être utilisés à des fins pédagogiques pour l'enseignement de la communication environnementale.
Membres du jury
Prof. Andrea Catellani (UCLouvain), co-promoteur
Dr. Louise-Amélie Cougnon (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Antonin Descampe (UCLouvain), président du jury
Prof. Øyvind Gjerstad (Université de Bergen), comité d’accompagnement
Prof. Céline Pascual Espuny (Aix-Marseille Université), évaluatrice externe
En savoir plus Yuliya Samofalova - Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations08 Jul08 Jul...
Yuliya Samofalova - Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations08 Jul08 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Yuliya Samofalova
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Communicating about climate change mitigation on social media: multimodal analysis of Instagram posts by Belgian, French, and Norwegian opinion-leading individuals and organizations”
Inscription
Abstract
Climate change is an urgent global issue requiring culturally relevant communication to foster sustainable practices. Despite diminished media coverage during the COVID-19 pandemic, the urgency of addressing the climate crisis remains relevant. In this study, we highlight the pivotal role of Instagram in shaping environmental discourses, emphasizing that communication effectiveness frequently depends on aligning opinion leader content with their established image and expertise.
Focusing on Instagram, one of the most popular visual social media platforms in Europe, the research examines the semiotic forms of discourses on pro-environmental efforts in the food, energy, and transport sectors as communicated by Belgian, French, and Norwegian environmental opinion leaders and opinion-leading organizations between January 2021 and March 2022. The study also evaluates how these messages are perceived by audiences in terms of obstacles to pro-environmental action and environmental values, contributing to a deeper understanding of the interplay between media content and audience attitudes.
We present an extensive corpus of Instagram posts (N=22882). Adopting a value-based approach from environmental psychology, this research draws on a mixed-method research design. We apply an automated content analysis based on a dictionary approach to select a specific corpus of posts concerning the food, energy, and transport themes. Multimodal content analysis of 2092 posts regarding the three sectors provides an overview of environmental discourses in Belgium, France, and Norway. To deeply examine how the obstacles to are communicated in the verbal and visual modes, we conduct four case studies. To examine how the obstacles, values, and narrative roles are represented in the case studies, we integrate multimodal discourse analysis and computer-assisted linguistic analysis of the posts. We combine content analysis, computer-assisted linguistic analysis, and sentiment analysis to investigate the obstacles, environmental values, and narrative roles that appeared in the comments.
By analyzing the variation in discourses shaping citizens’ beliefs and actions towards pro-environmental behavior, this research provides insights into European opinions on solutions and barriers or obstacles to climate change mitigation in the three sectors. The findings have implications for future environmental communication strategies, highlighting the need for coherent digital communication and the potential of social media to motivate pro-environmental action. Besides practical implications, this study is a valuable methodological contribution combining different computational and manual approaches to social media data. In addition, the collected corpora can be used for pedagogical implications for teaching Environmental Communication.
Résumé
Le changement climatique est un problème mondial urgent qui nécessite une communication culturellement pertinente pour encourager les pratiques durables. Malgré une couverture médiatique réduite lors de la pandémie de COVID-19, l'urgence de faire face à la crise climatique reste d'actualité. Dans cette étude, nous soulignons le rôle central d'Instagram dans la formation des discours environnementaux, en insistant sur le fait que l'efficacité de la communication dépend souvent de l'alignement du contenu des leaders d'opinion sur leur image et leur expertise.
En se concentrant sur Instagram, l'une des plateformes de médias sociaux visuels les plus populaires en Europe, la présente recherche examine les formes sémiotiques des discours sur les efforts pro-environnementaux dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, et des transports communiqués par les leaders d'opinion environnementaux belges, français et norvégiens entre janvier 2021 et mars 2022. L'étude évalue également comment ces messages sont perçus par les publics en termes d'obstacles à l'action pro-environnementale et de valeurs environnementales, contribuant ainsi à une compréhension plus approfondie de l'interaction entre le contenu des médias et les attitudes du public.
Nous présentons un vaste corpus de posts Instagram (N=22882). Adoptant une approche fondée sur les valeurs de la psychologie environnementale, cette étude s'appuie sur un modèle de recherche mixte. Nous appliquons une analyse de contenu automatisée établie sur une approche par dictionnaire pour sélectionner un corpus spécifique de messages concernant les thèmes de l'alimentation, de l'énergie, et des transports. L'analyse multimodale du contenu de 2092 messages concernant les trois secteurs donne un aperçu des discours environnementaux en Belgique, en France, et en Norvège. Afin d'examiner en profondeur la manière dont les obstacles sont communiqués dans les modes verbal et visuel, nous menons quatre études de cas. Pour examiner comment les obstacles, les valeurs, et les rôles narratifs sont représentés dans les études de cas, nous intégrons l'analyse multimodale du discours et l'analyse linguistique assistée par ordinateur pour investiguer les posts choisis. Nous combinons l'analyse du contenu, l'analyse linguistique assistée par ordinateur, et l'analyse des sentiments pour étudier les obstacles, les valeurs environnementales, et les rôles narratifs qui apparaissent dans les commentaires.
En analysant la variation des discours qui façonnent les croyances et les actions des citoyens en faveur d'un comportement pro-environnemental, cette recherche donne un aperçu des opinions européennes sur les solutions et les barrières ou obstacles à l'atténuation du changement climatique dans les trois secteurs. Les résultats ont des implications pour les futures stratégies de communication environnementale, soulignant la nécessité d'une communication numérique cohérente et le potentiel des médias sociaux pour motiver les actions pro-environnementales. Outre les implications pratiques, cette étude est une contribution méthodologique précieuse combinant différentes approches informatiques et manuelles des données des médias sociaux. En outre, les corpus collectés peuvent être utilisés à des fins pédagogiques pour l'enseignement de la communication environnementale.
Membres du jury
Prof. Andrea Catellani (UCLouvain), co-promoteur
Dr. Louise-Amélie Cougnon (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Antonin Descampe (UCLouvain), président du jury
Prof. Øyvind Gjerstad (Université de Bergen), comité d’accompagnement
Prof. Céline Pascual Espuny (Aix-Marseille Université), évaluatrice externe
-
 Monica Baur - La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)16 Apr16 Apr...
Monica Baur - La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)16 Apr16 Apr...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Monica Baur
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)
Inscription - Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale porte sur les pratiques de vulgarisation scientifique de vidéastes sur YouTube et de podcasteur·euses francophones indépendants. La vulgarisation renvoie à des pratiques se déployant sur différents supports, dont l’objectif est de diffuser des connaissances en dehors d’un cadre formel, à destination de publics variés généralement considérés comme non spécialistes.
Monica Baur s’est entretenue avec 60 vulgarisateur·trices et a mené une analyse de contenus (vidéos et podcasts scientifiques) ainsi qu’une ethnographie en ligne. Les thèmes traités sont relatifs aux sciences au sens large : les sciences naturelles, expérimentales et formelles (chimie, biologie, mathématiques, etc.), les sciences humaines et sociales (histoire, linguistique, etc.) et les sujets de culture générale et de société.
Plusieurs axes structurent cette thèse, dont l’objectif est de comprendre et de mieux connaître comment des amateurs de sciences (au sens premier du terme, à savoir qui aiment les sciences) rendent leurs connaissances accessibles en publiant des contenus en ligne. D’abord, la chercheuse s’est intéressée au sentiment de légitimité et d’expertise des vulgarisateur·trices. La question de la source du message semble d’autant plus épineuse qu’elle touche des sujets qui ont potentiellement un fort impact sur les représentations du public. Un chapitre traite également du parcours et du profil de ces créateur·trices, mettant notamment en avant l’importance du parcours autodidacte dans le développement de leurs connaissances et dans la transmission de celles-ci.
Monica Baur met ensuite en lumière le phénomène de plateformisation de la vulgarisation, c’est-à-dire le fait que les activités de médiation des savoirs sont liées aux contraintes et logiques des plateformes. Démonétisations, politiques changeantes, suppression de fonctionnalités, compréhension des algorithmes : les vulgarisateur·trices sont amenés à faire face à différents défis relevant de la création de contenu sur Internet.
La chercheuse consacre aussi une partie à la mise en forme et à la mise en scène de la vulgarisation, du choix du sujet jusqu’à la promotion des contenus sur les réseaux sociaux, en passant par l’usage des figures de styles et la méthodologie de recherche et de consultation des sources.
Enfin, un dernier chapitre concerne les collaborations entre acteurs traditionnels de la médiation scientifique et culturelle (musées, institutions scientifiques, etc.) et vulgarisateur·trices du web. Ce type de collaborations a été popularisé notamment par les vidéos réalisées entre le Louvre et différents vidéastes dont Benjamin Brillaud de la chaîne d’histoire Nota Bene. Monica Baur a adressé un questionnaire à différents profils d’acteurs culturels et institutionnels (responsables pédagogiques, enseignants-chercheurs, chargés de médiation, etc.). Ces partenariats renvoient à une gamme très variée d’activités comme la création de vidéos ou d’épisodes de podcasts sur demande, la relecture de textes, la commande d’illustrations, le soutien logistique ou documentaire, que ces projets soient rémunérés ou non. Les vulgarisateur·trices peuvent jouer un rôle intéressant pour construire des projets avec d’autres acteurs de la diffusion scientifique.
Membres du jury
Prof. Thibault Philippette (UCLouvain), co-promoteur et secrétaire du jury
Prof. Paul Bertrand (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Jean-François Rees (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Mélanie Millette (UQAM), évaluatrice externeEn savoir plus Monica Baur - La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)16 Apr16 Apr...
Monica Baur - La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)16 Apr16 Apr...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Monica Baur
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
La vulgarisation scientifique sur le web. Étude des pratiques de vulgarisation de vidéastes et de podcasteur·euses francophones indépendants (2020-2023)
Inscription - Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale porte sur les pratiques de vulgarisation scientifique de vidéastes sur YouTube et de podcasteur·euses francophones indépendants. La vulgarisation renvoie à des pratiques se déployant sur différents supports, dont l’objectif est de diffuser des connaissances en dehors d’un cadre formel, à destination de publics variés généralement considérés comme non spécialistes.
Monica Baur s’est entretenue avec 60 vulgarisateur·trices et a mené une analyse de contenus (vidéos et podcasts scientifiques) ainsi qu’une ethnographie en ligne. Les thèmes traités sont relatifs aux sciences au sens large : les sciences naturelles, expérimentales et formelles (chimie, biologie, mathématiques, etc.), les sciences humaines et sociales (histoire, linguistique, etc.) et les sujets de culture générale et de société.
Plusieurs axes structurent cette thèse, dont l’objectif est de comprendre et de mieux connaître comment des amateurs de sciences (au sens premier du terme, à savoir qui aiment les sciences) rendent leurs connaissances accessibles en publiant des contenus en ligne. D’abord, la chercheuse s’est intéressée au sentiment de légitimité et d’expertise des vulgarisateur·trices. La question de la source du message semble d’autant plus épineuse qu’elle touche des sujets qui ont potentiellement un fort impact sur les représentations du public. Un chapitre traite également du parcours et du profil de ces créateur·trices, mettant notamment en avant l’importance du parcours autodidacte dans le développement de leurs connaissances et dans la transmission de celles-ci.
Monica Baur met ensuite en lumière le phénomène de plateformisation de la vulgarisation, c’est-à-dire le fait que les activités de médiation des savoirs sont liées aux contraintes et logiques des plateformes. Démonétisations, politiques changeantes, suppression de fonctionnalités, compréhension des algorithmes : les vulgarisateur·trices sont amenés à faire face à différents défis relevant de la création de contenu sur Internet.
La chercheuse consacre aussi une partie à la mise en forme et à la mise en scène de la vulgarisation, du choix du sujet jusqu’à la promotion des contenus sur les réseaux sociaux, en passant par l’usage des figures de styles et la méthodologie de recherche et de consultation des sources.
Enfin, un dernier chapitre concerne les collaborations entre acteurs traditionnels de la médiation scientifique et culturelle (musées, institutions scientifiques, etc.) et vulgarisateur·trices du web. Ce type de collaborations a été popularisé notamment par les vidéos réalisées entre le Louvre et différents vidéastes dont Benjamin Brillaud de la chaîne d’histoire Nota Bene. Monica Baur a adressé un questionnaire à différents profils d’acteurs culturels et institutionnels (responsables pédagogiques, enseignants-chercheurs, chargés de médiation, etc.). Ces partenariats renvoient à une gamme très variée d’activités comme la création de vidéos ou d’épisodes de podcasts sur demande, la relecture de textes, la commande d’illustrations, le soutien logistique ou documentaire, que ces projets soient rémunérés ou non. Les vulgarisateur·trices peuvent jouer un rôle intéressant pour construire des projets avec d’autres acteurs de la diffusion scientifique.
Membres du jury
Prof. Thibault Philippette (UCLouvain), co-promoteur et secrétaire du jury
Prof. Paul Bertrand (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Jean-François Rees (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Mélanie Millette (UQAM), évaluatrice externe -
 Géraldine Wuyckens - Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education18 Jan18 Jan...
Géraldine Wuyckens - Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education18 Jan18 Jan...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Géraldine Wuyckens
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education”
Lien Teams

Abstract
The thesis discusses the concept of design fiction and its application in media education. Design fiction is a creative practice that combines speculative design and science fiction to explore possible futures for new technologies. The doctoral research advocates for incorporating design fiction into media education to prompt students’ critical reflection on digital media and technology. Aligned with the objectives of media education, this approach encourages a deeper understanding of media through inquiry-based learning theories. The study introduces an educational program and assessment rubric developed in collaboration with the Belgian association Action Médias Jeunes, illustrating how exploring speculative futures fosters reflection on societal issues and personal media practices. Through a design-based research project, the thesis demonstrates that design fiction contributes to develop a critical inquiry method, enhancing students’ competence in questioning digital media and technology, ultimately contributing to their development of critical thinking competences. The results highlight the effectiveness of design fiction in prompting students to formulate hypotheses about the future, create diegetic prototypes, and generate speculative scenarios.
Résumé
La thèse porte sur le concept du design fiction et son application dans le domaine de l’éducation aux médias. Le design fiction est une pratique créative qui combine le design spéculatif et la science-fiction pour explorer les futurs possibles des nouvelles technologies. La recherche doctorale utilise le design fiction en éducation aux médias afin de stimuler la réflexion critique des élèves sur les médias numériques et les nouvelles technologies. En accord avec les objectifs de l'éducation aux médias, cette approche encourage une compréhension approfondie des médias par le bais des théories d’apprentissage basées sur l’enquête. La thèse présente un module pédagogique et une grille d'évaluation développés en collaboration avec l'association belge Action Médias Jeunes, illustrant comment l'exploration des futurs spéculatifs favorise la réflexion sur les enjeux sociétaux et les pratiques médiatiques personnelles. À travers un projet de recherche basé sur la conception (design-based research), la recherche démontre que le design fiction contribue au développement d'une méthode d'enquête critique, améliorant la compétence des élèves à questionner les médias numériques et les nouvelles technologies, contribuant ainsi au développement de leur pensée critique. Les résultats mettent en évidence l'efficacité du design fiction pour amener les élèves à formuler des hypothèses sur le futur, créer des prototypes diégétiques et générer des scénarios spéculatifs.
Membres du jury
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur
Prof. Sébastien Fevry (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Martin Lalonde (Université du Québec à Montréal), comité d’accompagnement
Prof. Sirkku Kotilainen (Tampere University), évaluatrice externe
Prof. Suzanne Kieffer (UCLouvain), présidente du juryEn savoir plus Géraldine Wuyckens - Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education18 Jan18 Jan...
Géraldine Wuyckens - Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education18 Jan18 Jan...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Géraldine Wuyckens
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
“Using Design Fiction to Develop a Critical Inquiry Method in Media Education”
Lien Teams

Abstract
The thesis discusses the concept of design fiction and its application in media education. Design fiction is a creative practice that combines speculative design and science fiction to explore possible futures for new technologies. The doctoral research advocates for incorporating design fiction into media education to prompt students’ critical reflection on digital media and technology. Aligned with the objectives of media education, this approach encourages a deeper understanding of media through inquiry-based learning theories. The study introduces an educational program and assessment rubric developed in collaboration with the Belgian association Action Médias Jeunes, illustrating how exploring speculative futures fosters reflection on societal issues and personal media practices. Through a design-based research project, the thesis demonstrates that design fiction contributes to develop a critical inquiry method, enhancing students’ competence in questioning digital media and technology, ultimately contributing to their development of critical thinking competences. The results highlight the effectiveness of design fiction in prompting students to formulate hypotheses about the future, create diegetic prototypes, and generate speculative scenarios.
Résumé
La thèse porte sur le concept du design fiction et son application dans le domaine de l’éducation aux médias. Le design fiction est une pratique créative qui combine le design spéculatif et la science-fiction pour explorer les futurs possibles des nouvelles technologies. La recherche doctorale utilise le design fiction en éducation aux médias afin de stimuler la réflexion critique des élèves sur les médias numériques et les nouvelles technologies. En accord avec les objectifs de l'éducation aux médias, cette approche encourage une compréhension approfondie des médias par le bais des théories d’apprentissage basées sur l’enquête. La thèse présente un module pédagogique et une grille d'évaluation développés en collaboration avec l'association belge Action Médias Jeunes, illustrant comment l'exploration des futurs spéculatifs favorise la réflexion sur les enjeux sociétaux et les pratiques médiatiques personnelles. À travers un projet de recherche basé sur la conception (design-based research), la recherche démontre que le design fiction contribue au développement d'une méthode d'enquête critique, améliorant la compétence des élèves à questionner les médias numériques et les nouvelles technologies, contribuant ainsi au développement de leur pensée critique. Les résultats mettent en évidence l'efficacité du design fiction pour amener les élèves à formuler des hypothèses sur le futur, créer des prototypes diégétiques et générer des scénarios spéculatifs.
Membres du jury
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur
Prof. Sébastien Fevry (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Martin Lalonde (Université du Québec à Montréal), comité d’accompagnement
Prof. Sirkku Kotilainen (Tampere University), évaluatrice externe
Prof. Suzanne Kieffer (UCLouvain), présidente du jury
-
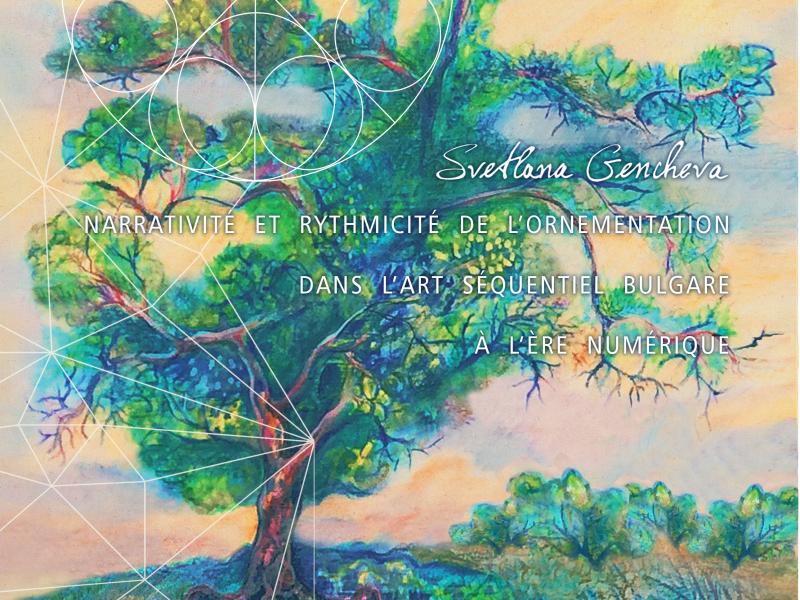 Svetlana Gencheva - Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique16 Oct16 Oct...
Svetlana Gencheva - Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique16 Oct16 Oct...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Svetlana Gencheva
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique
Pour participer à la soutenance à distance, envoyer un email à svetlana.gencheva@uclouvain.be pour le 12 octobre
Résumé
La thèse « Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique » explore la constellation narrative des auteurs et des collectifs majeurs de l’art séquentiel bulgare des quinze dernières années. Notre étude transversale englobe non seulement l’art séquentiel de la bande dessinée, mais également d’autres domaines tels que l’animation, le Gif Art, les récits mixed médias et les fictions transmédias. La réflexion de cette thèse est focalisée sur la rythmicité et le fonctionnement narratif du système de l'ornementation dans les récits visuels contemporains en Bulgarie. La méthode de l'effet miroir , basée sur l'analyse d'entretiens et l'expression des acteurs, a guidé l'extraction du corpus, la création d'une grille d'analyse, ainsi que l'interprétation des résultats. C'est par le biais de l'analyse des œuvres que la recherche met en lumière la manière dont l'art séquentiel bulgare réinvente son imaginaire à l’ère numérique.
Membres du jury
Dr Philippe Marion (UCLouvain), promoteur
Dr Sarah Sepulchre (UCLouvain), co-promotrice
Dr Sébastien Fevry (UCLouvain), président du jury
Dr Denis Mellier (Université de Poitiers), comité d’accompagnement
Dr Viviane Alary, (Université Clermont Auvergne), évaluatrice externe
En savoir plus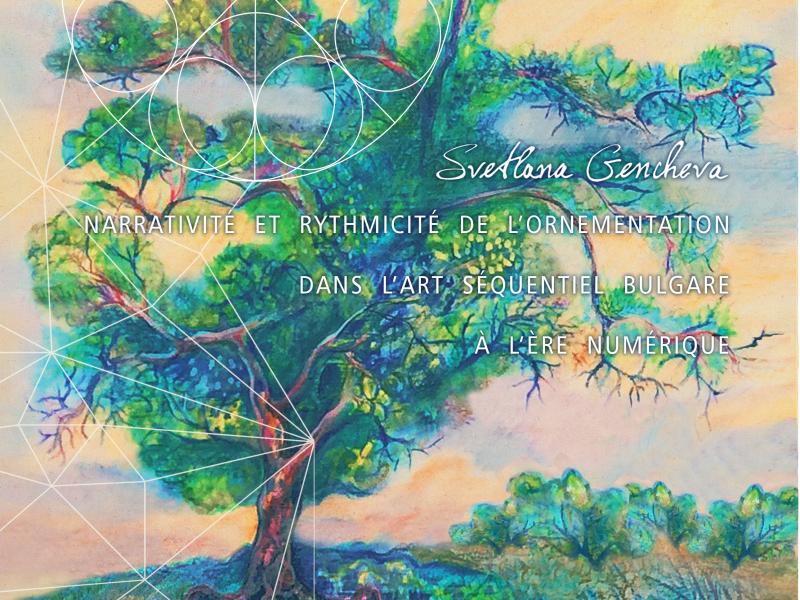 Svetlana Gencheva - Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique16 Oct16 Oct...
Svetlana Gencheva - Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique16 Oct16 Oct...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Svetlana Gencheva
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique
Pour participer à la soutenance à distance, envoyer un email à svetlana.gencheva@uclouvain.be pour le 12 octobre
Résumé
La thèse « Narrativité et rythmicité de l’ornementation dans l’art séquentiel bulgare à l'ère numérique » explore la constellation narrative des auteurs et des collectifs majeurs de l’art séquentiel bulgare des quinze dernières années. Notre étude transversale englobe non seulement l’art séquentiel de la bande dessinée, mais également d’autres domaines tels que l’animation, le Gif Art, les récits mixed médias et les fictions transmédias. La réflexion de cette thèse est focalisée sur la rythmicité et le fonctionnement narratif du système de l'ornementation dans les récits visuels contemporains en Bulgarie. La méthode de l'effet miroir , basée sur l'analyse d'entretiens et l'expression des acteurs, a guidé l'extraction du corpus, la création d'une grille d'analyse, ainsi que l'interprétation des résultats. C'est par le biais de l'analyse des œuvres que la recherche met en lumière la manière dont l'art séquentiel bulgare réinvente son imaginaire à l’ère numérique.
Membres du jury
Dr Philippe Marion (UCLouvain), promoteur
Dr Sarah Sepulchre (UCLouvain), co-promotrice
Dr Sébastien Fevry (UCLouvain), président du jury
Dr Denis Mellier (Université de Poitiers), comité d’accompagnement
Dr Viviane Alary, (Université Clermont Auvergne), évaluatrice externe
-
 Christel Christophe - L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux18 Sep18 Sep...
Christel Christophe - L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux18 Sep18 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Christel Christophe
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux
Formulaire d’inscription - Lien teams
Résumé
Cette recherche doctorale porte sur l'émergence organisationnelle, soit la période du cycle de vie d'une organisation lorsqu'elle est en création. La recherche se base sur une étude de cas qui concerne la mise en place d'un projet de centre d'accompagnement pour entrepreneurs sociaux à Bruxelles, financé par des fonds européens. L'approche utilisée est l'ethnographie, et l'étude se fonde sur le cadre théorique de la Communication Constitutive des Organisations (CCO) ainsi que sur la théorie de l'enquête de John Dewey.
Partant des points de vue des acteurs en charge de la mise en place du projet, Christel Christophe tente de comprendre comment les conversations et les pratiques s'inscrivent dans un processus d'émergence organisationnelle et prennent corps dans une logique d'enquête. En effet, si la conduite de tout projet fait appel à des pratiques qui déterminent en partie son développement et sont marquées par un contexte sociopolitique, le projet appartient également à la catégorie du devenir. Celle-ci comporte une part d'incertitude et engage les acteurs dans des situations qui les interpellent, les questionnent et les font douter.
Les données de la recherche, issues de l'observation participante, d'entretiens individuels et collectifs, constituées sur une période prolongée, offrent une perspective longitudinale capable d'appréhender les évolutions de la mise en place du projet. Elles permettent également de voir comment les acteurs se racontent, interprètent réflexivement leur expérience du projet et se saisissent de celui-ci comme d'un espace d'expérimentation qui structure l'organisation émergente.
Abstract
This doctoral research focuses on organizational emergence, the period in an organization's life cycle when it is being created. The research is based on a case study of a project to set up a support center for social entrepreneurs in Brussels, financed by European funds. The approach used is ethnography, and the study is based on the theoretical framework of Constitutive Communication of Organizations (CCO) and John Dewey's theory of inquiry.
Drawing on the points of view of the actors in charge of setting up the project, Christel Christophe seeks to understand how conversations and practices become part of a process of organizational emergence and take shape in a logic of inquiry. Indeed, while the conduct of any project calls on practices that partly determine its development and are marked by a socio-political context, the project also belongs to the category of becoming. This involves a degree of uncertainty, and engages actors in situations that challenge, question, and cast doubt on them.
The research data, derived from participant observation, individual and group interviews, and built up over an extended period, offer a longitudinal perspective capable of apprehending the evolutions of the project's implementation. They also enable us to grasp how the players relate to and reflexively interpret their experience of the project, and how they use it as a space for experimentation that structures the emerging organization.
Membres du jury
Prof. Sandrine Roginsky (UCLouvain), co-promotrice
Prof. François Lambotte (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Sophie Del Fa (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Amaia Errecart (Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité), comité d’accompagnement
Prof. Nicolas Bencherki (Université TÉLUQ), évaluateur externeEn savoir plus Christel Christophe - L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux18 Sep18 Sep...
Christel Christophe - L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux18 Sep18 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Christel Christophe
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du grade de Doctorat en information et communication
L’émergence organisationnelle par le travail d’enquête. Une approche communicationnelle d’inspiration pragmatiste pour l’étude de la mise en place d’un projet de centre d’accompagnement pour entrepreneurs sociaux
Formulaire d’inscription - Lien teams
Résumé
Cette recherche doctorale porte sur l'émergence organisationnelle, soit la période du cycle de vie d'une organisation lorsqu'elle est en création. La recherche se base sur une étude de cas qui concerne la mise en place d'un projet de centre d'accompagnement pour entrepreneurs sociaux à Bruxelles, financé par des fonds européens. L'approche utilisée est l'ethnographie, et l'étude se fonde sur le cadre théorique de la Communication Constitutive des Organisations (CCO) ainsi que sur la théorie de l'enquête de John Dewey.
Partant des points de vue des acteurs en charge de la mise en place du projet, Christel Christophe tente de comprendre comment les conversations et les pratiques s'inscrivent dans un processus d'émergence organisationnelle et prennent corps dans une logique d'enquête. En effet, si la conduite de tout projet fait appel à des pratiques qui déterminent en partie son développement et sont marquées par un contexte sociopolitique, le projet appartient également à la catégorie du devenir. Celle-ci comporte une part d'incertitude et engage les acteurs dans des situations qui les interpellent, les questionnent et les font douter.
Les données de la recherche, issues de l'observation participante, d'entretiens individuels et collectifs, constituées sur une période prolongée, offrent une perspective longitudinale capable d'appréhender les évolutions de la mise en place du projet. Elles permettent également de voir comment les acteurs se racontent, interprètent réflexivement leur expérience du projet et se saisissent de celui-ci comme d'un espace d'expérimentation qui structure l'organisation émergente.
Abstract
This doctoral research focuses on organizational emergence, the period in an organization's life cycle when it is being created. The research is based on a case study of a project to set up a support center for social entrepreneurs in Brussels, financed by European funds. The approach used is ethnography, and the study is based on the theoretical framework of Constitutive Communication of Organizations (CCO) and John Dewey's theory of inquiry.
Drawing on the points of view of the actors in charge of setting up the project, Christel Christophe seeks to understand how conversations and practices become part of a process of organizational emergence and take shape in a logic of inquiry. Indeed, while the conduct of any project calls on practices that partly determine its development and are marked by a socio-political context, the project also belongs to the category of becoming. This involves a degree of uncertainty, and engages actors in situations that challenge, question, and cast doubt on them.
The research data, derived from participant observation, individual and group interviews, and built up over an extended period, offer a longitudinal perspective capable of apprehending the evolutions of the project's implementation. They also enable us to grasp how the players relate to and reflexively interpret their experience of the project, and how they use it as a space for experimentation that structures the emerging organization.
Membres du jury
Prof. Sandrine Roginsky (UCLouvain), co-promotrice
Prof. François Lambotte (UCLouvain), co-promoteur
Prof. Sophie Del Fa (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Amaia Errecart (Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité), comité d’accompagnement
Prof. Nicolas Bencherki (Université TÉLUQ), évaluateur externe -
 Joanne Jojczyk - Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture05 May05 May...
Joanne Jojczyk - Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture05 May05 May...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Joanne Jojczyk
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Doctorat en information et communication
“Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs - Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture »”
Lien Teams
Résumé
Durant deux ans et demi, Joanne Jojczyk a suivi huit groupes composés d’habitants, d’associations et d’artistes dans la conception d’un événement festif et artistique sur leur territoire. A travers une étude ethnographique filmée, elle s’intéresse à la façon dont ces concepteurs ont construit ces huit projets à l’aide d’une équipe de médiation culturelle. Ce sont les interactions qui peuplent ces réunions et forment le projet au fil du temps qui sont au centre des réflexions théoriques et analytiques de la chercheuse. Ainsi, le cadre théorique au centre de la thèse s’appuie sur les travaux de l’école de Montréal et les approches communicationnelles constitutives de l’organisation. A travers trois études de cas, Joanne Jojczyk interroge les concepts de participation, de projet et d’imaginaire. Les conclusions de la thèse montrent comment le tissage du projet s’opère au fil du temps via des mouvements à la fois créatifs et pragmatiques dans des moments d’interaction. Pour finir, la thèse nous éclaire sur le concept de « décalage » dans le secteur culturel mais aussi plus globalement dans la conduite de projet.
Membres du jury
Pr François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Pr Philippe Scieur (UCLouvain), Président du jury
Pr Damien Vanneste (UCLouvain), Secrétaire du jury
Pr Magali Sizorn (Université de Rouen), évaluatrice externe
Pr Consuelo Vàsquez (UQAM), comité d’accompagnement
En savoir plus Joanne Jojczyk - Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture05 May05 May...
Joanne Jojczyk - Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture05 May05 May...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Joanne Jojczyk
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Doctorat en information et communication
“Entre pragmatique et créativité, la constitution des imaginaires au sein de projets de territoire participatifs - Une ethnographie du projet le « Grand Huit » issu de l’initiative « Mons 2015, Capitale européenne de la culture »”
Lien Teams
Résumé
Durant deux ans et demi, Joanne Jojczyk a suivi huit groupes composés d’habitants, d’associations et d’artistes dans la conception d’un événement festif et artistique sur leur territoire. A travers une étude ethnographique filmée, elle s’intéresse à la façon dont ces concepteurs ont construit ces huit projets à l’aide d’une équipe de médiation culturelle. Ce sont les interactions qui peuplent ces réunions et forment le projet au fil du temps qui sont au centre des réflexions théoriques et analytiques de la chercheuse. Ainsi, le cadre théorique au centre de la thèse s’appuie sur les travaux de l’école de Montréal et les approches communicationnelles constitutives de l’organisation. A travers trois études de cas, Joanne Jojczyk interroge les concepts de participation, de projet et d’imaginaire. Les conclusions de la thèse montrent comment le tissage du projet s’opère au fil du temps via des mouvements à la fois créatifs et pragmatiques dans des moments d’interaction. Pour finir, la thèse nous éclaire sur le concept de « décalage » dans le secteur culturel mais aussi plus globalement dans la conduite de projet.
Membres du jury
Pr François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Pr Philippe Scieur (UCLouvain), Président du jury
Pr Damien Vanneste (UCLouvain), Secrétaire du jury
Pr Magali Sizorn (Université de Rouen), évaluatrice externe
Pr Consuelo Vàsquez (UQAM), comité d’accompagnement
Thèses défendues en 2016
08/09/2016
Detry Lionel, ‘L’écoute musicale mobile : un art de faire – Analyse de l’appropriation socio-technique du baladeur MP3’
Promoteur : Thierry De Smedt
06/07/2016
Mnasri Slaheddine, ‘Trivialization and Detrivialization in Cancer Research : Knowing, Unknowing and Meta-knowing (A Discursive Psychology Study)
Promoteur : François Lambotte
29/04/2016
Jacques Jerry, ‘Définition des compétences propres à l’organisation des collections d’informations personnelles numériques
Promoteur : Pierre Fastrez
Thèses défendues en 2015
11/09/2015
Emmanuel Wathelet, " Autorité et auteurités émergentes dans un environnement organisationnel non-hiérarchisé en ligne : le cas de la construction de règles sur Wikipédia".
Promoteur: François Lambotte
27/03/2015
Jean-Claude Likosi, "Récit électoral 2006 et dynamique presse-politique en RD Congo. Contribution à une socio-narratologie médiatique".
Promoteur: Marc Lits
23/04/2015
Olivier Standaert, "Le journalisme flexible. Trajectoires d’insertion, identités professionnelles et marché du travail des jeunes journalistes de Belgique francophone"
Promoteurs: Benoït Grévisse et Gérard Derèze
27/03/2015
Aurélie Brouwers, "La recherche d'information dans un environnement hypermédia: Le rôle des habiletés visuo-spatiales"
Promoteur: Pierre Fastrez
Thèses défendues en 2014
05/12/2014
Bellarminus Gildas Kakpovi, 'La communication politique au Bénin (1945 à 2011) : Vers la naissance d'une profession ?'
Promoteurs: Marc Lits et Marie-Soleil Frère (ULB)
02/10/2014
Sophie Pochet, 'L'Attitude des futurs publicitaires envers la publicité et son éthique. Analyse compréhensive des représentations sociales en la matière d'un corpus d'étudiants de l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales.'
Promoteur: Philippe Marion
19/09/2014
Nicolas Baygert, 'Les marques politiques : réenchantement ou chant du cygne de l'activisme citoyen ?'
Promoteurs: Prof. Nicole d'Almeida (Université Paris-Sorbonne), Prof. Thierry Libaert
09/09/2014
Thibault Philippette, Bien jouer ensemble: Les activités de coordination des joureus de jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs (Information et Communication)
Promoteur: Pierre Fastrez
27/06/2014
Eugénie Arbid Mouchantaf, La guerre de juillet 2006 à travers les éditoriaux des journaux An-Nahar et As-Safir (Information et Communication)
Promoteurs : Prof. Lits & Prof. Mirna Abou Zeid
22/05/2014
Jean-Claude Jouret, Hergé et Tintin: de l'abbé Wallez à Steven Spielberg...(Information et Communication)
Promoteur : Philippe Marion
25/04/2014
Marie Vanoost, Le journalisme narratif aux Etats-Unis et en Europe francophone: Modélisation et enjeux éthiques. (Information et Communication)
Promoteur: Benoît Grévisse
27/03/2017
Ntiranyibagira Pierre Claver, ‘Communication et construction identitaire des partis politiques au Burundi : lecture sémioculturelle’
Promoteur : Philippe Marion
-
 Pudens Malibabo Lavu - Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC)18 Nov18 Nov...
Pudens Malibabo Lavu - Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC)18 Nov18 Nov...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Pudens Malibabo Lavu
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC) »
Résumé
Comment les modèles culturels des journalistes relatifs aux effets écologiques de l’habitat humain (déchets, pollutions, érosions, etc.) se présentent comme des entités potentiellement agissantes et dynamiques, à travers les éco-reportages dédiés à ces effets et les propos des journalistes eux-mêmes sur les conditions de production de ces éco-reportages ? Telle est la question fondamentale de la présente thèse. Pour y répondre, l’étude inscrit le triptyque « journaliste – modèle culturel – texte » au cœur de l’analyse de la configuration du sens des discours journalistiques sur les constructions anarchiques, les déchaînements des phénomènes de la Nature (pluies diluviennes, inondations, érosions et sécheresse) et les pollutions (sonore, du sol, de l’air et des eaux). De là, elle procède par une triple analyse, sémantique, structurale et narrative, d’un corpus de trois-cent-trente-cinq éco-reportages de 2011 et de 2016, et de vingt-huit heures et demie d’entretiens semi-directifs réalisés avec vingt-quatre journalistes en fin 2016 - début 2017 sur les conditions sociales et professionnelles de production de ces reportages. Au terme de la triple exploration de ce corpus, le triptyque « population – pouvoirs publics – journaliste » s’est révélé comme le nœud de la compréhension des modèles culturels en question. L’étude parvient à démontrer que ces modèles culturels impliquent un double jeu d’omission de certaines causes anthropiques et de certains effets de la dégradation de l’habitat humain. Ils sont stables et durables entre 2011, 2016 et 2017. Le journaliste les a assimilés entre autres auprès de ses parents et durant son cursus scolaire et académique. Ils sont de l’ordre « des contraintes ou des potentialités qui s’ancrent dans le système d’action – familial, amical ou professionnel – dans lequel [le journaliste est engagé] » (Alami, et. al., 2009 : 14). Ces contraintes et potentialités sont bien présentes dans les expériences personnelles et professionnelles du journaliste avec l’environnement, lesquelles expériences comportent les raisons d’écriture d’informations journalistiques analysées. Liés à ces expériences et sous-jacents à ces informations, les modèles culturels identifiés dans cette étude sont fortement dysfonctionnels, étant donné qu’ils impliquent davantage des facteurs qui ne servent pas à l’assainissement de l’habitat humain. Mais, entretemps, ils tendent faiblement à mobiliser certaines actions individuelles et collectives qui assurent la salubrité publique. De ce fait, par rapport à la population, qui est directement touchée par le problème d’assainissement urbain et se démène parfois à sa manière pour s’en sortir, et les pouvoir publics, qui sont censés y remédier de façon efficace et durable, le journaliste s’auto-définit comme un veilleur-lanceur d’alerte en assainissement urbain. Dans cette position, il se présente comme n’ayant qu’un seul objectif : éveiller les consciences pour que l’environnement soit assaini des constructions anarchiques, des déchets, des inondations, des érosions et des pollutions.
Abstract
How do the cultural models of journalists relating to the ecological effects of human habitat (waste, pollution, erosion, etc.) present themselves as potentially active and dynamic entities, through the eco-reports dedicated to these effects and the comments of the journalists themselves on the conditions of production of these eco-reports? This is the fundamental question of this thesis. To answer it, the study places the triptych "journalist - cultural model - text" at the heart of the analysis of the configuration of the meaning of journalistic discourse on anarchic constructions, the unleashing of natural phenomena (heavy rains, floods, erosion and drought) and pollution (noise, soil, air and water). From there, it proceeds with a triple analysis, semantic, structural and narrative, of a corpus of three hundred and thirty-five eco-reports from 2011 and 2016, and twenty-eight and a half hours of semi-directive interviews conducted with twenty-four journalists in late 2016 - early 2017 on the social and professional conditions of production of these reports. At the end of the triple exploration of this corpus, the triptych "population - public authorities - journalist" emerged as the key to understanding the cultural models in question. The study succeeded in demonstrating that these cultural models imply a double game of omission of certain anthropic causes and certain effects of the degradation of the human habitat. They are stable and sustainable between 2011, 2016 and 2017. The journalist has assimilated them among others with his parents and during his school and academic curriculum. They are of the order of "constraints or potentialities that are anchored in the system of action - family, friends or professional - in which [the journalist is involved]" (Alami, et. al., 2009: 14). These constraints and potentialities are present in the journalist's personal and professional experiences with the environment, which include the reasons for writing the journalistic information being analyzed. Linked to these experiences and underlying this information, the cultural models identified in this study are highly dysfunctional, since they involve more factors that do not serve to sanitize the human habitat. But, in the meantime, they have a weak tendency to mobilize certain individual and collective actions that ensure public health. As a result, in relation to the population, which is directly affected by the urban sanitation problem and sometimes struggles in its own way to get out of it, and the public authorities, which are supposed to remedy it in an effective and sustainable way, the journalist defines himself as an urban sanitation watchdog. In this position, he has only one goal: to raise awareness so that the environment is cleaned up from anarchic constructions, waste, floods, erosion and pollution.
Membres du jury
Professeur Andrea Catellani (UCLouvain, Belgique), co-promoteur et secrétaire
Professeur émérite Philippe Marion (UCLouvain, Belgique), co-promoteur
Professeur émérite Marc Lits (UCLouvain, Belgique), président du jury
Maître de conférences Béatrice Jalenques-Vigouroux (INSA Toulouse, France), membre
Maître de conférences Marie Fierens (ULB, Belgique), membreEn savoir plus Pudens Malibabo Lavu - Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC)18 Nov18 Nov...
Pudens Malibabo Lavu - Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC)18 Nov18 Nov...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Pudens Malibabo Lavu
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Récit environnemental et construction des modèles culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDC) »
Résumé
Comment les modèles culturels des journalistes relatifs aux effets écologiques de l’habitat humain (déchets, pollutions, érosions, etc.) se présentent comme des entités potentiellement agissantes et dynamiques, à travers les éco-reportages dédiés à ces effets et les propos des journalistes eux-mêmes sur les conditions de production de ces éco-reportages ? Telle est la question fondamentale de la présente thèse. Pour y répondre, l’étude inscrit le triptyque « journaliste – modèle culturel – texte » au cœur de l’analyse de la configuration du sens des discours journalistiques sur les constructions anarchiques, les déchaînements des phénomènes de la Nature (pluies diluviennes, inondations, érosions et sécheresse) et les pollutions (sonore, du sol, de l’air et des eaux). De là, elle procède par une triple analyse, sémantique, structurale et narrative, d’un corpus de trois-cent-trente-cinq éco-reportages de 2011 et de 2016, et de vingt-huit heures et demie d’entretiens semi-directifs réalisés avec vingt-quatre journalistes en fin 2016 - début 2017 sur les conditions sociales et professionnelles de production de ces reportages. Au terme de la triple exploration de ce corpus, le triptyque « population – pouvoirs publics – journaliste » s’est révélé comme le nœud de la compréhension des modèles culturels en question. L’étude parvient à démontrer que ces modèles culturels impliquent un double jeu d’omission de certaines causes anthropiques et de certains effets de la dégradation de l’habitat humain. Ils sont stables et durables entre 2011, 2016 et 2017. Le journaliste les a assimilés entre autres auprès de ses parents et durant son cursus scolaire et académique. Ils sont de l’ordre « des contraintes ou des potentialités qui s’ancrent dans le système d’action – familial, amical ou professionnel – dans lequel [le journaliste est engagé] » (Alami, et. al., 2009 : 14). Ces contraintes et potentialités sont bien présentes dans les expériences personnelles et professionnelles du journaliste avec l’environnement, lesquelles expériences comportent les raisons d’écriture d’informations journalistiques analysées. Liés à ces expériences et sous-jacents à ces informations, les modèles culturels identifiés dans cette étude sont fortement dysfonctionnels, étant donné qu’ils impliquent davantage des facteurs qui ne servent pas à l’assainissement de l’habitat humain. Mais, entretemps, ils tendent faiblement à mobiliser certaines actions individuelles et collectives qui assurent la salubrité publique. De ce fait, par rapport à la population, qui est directement touchée par le problème d’assainissement urbain et se démène parfois à sa manière pour s’en sortir, et les pouvoir publics, qui sont censés y remédier de façon efficace et durable, le journaliste s’auto-définit comme un veilleur-lanceur d’alerte en assainissement urbain. Dans cette position, il se présente comme n’ayant qu’un seul objectif : éveiller les consciences pour que l’environnement soit assaini des constructions anarchiques, des déchets, des inondations, des érosions et des pollutions.
Abstract
How do the cultural models of journalists relating to the ecological effects of human habitat (waste, pollution, erosion, etc.) present themselves as potentially active and dynamic entities, through the eco-reports dedicated to these effects and the comments of the journalists themselves on the conditions of production of these eco-reports? This is the fundamental question of this thesis. To answer it, the study places the triptych "journalist - cultural model - text" at the heart of the analysis of the configuration of the meaning of journalistic discourse on anarchic constructions, the unleashing of natural phenomena (heavy rains, floods, erosion and drought) and pollution (noise, soil, air and water). From there, it proceeds with a triple analysis, semantic, structural and narrative, of a corpus of three hundred and thirty-five eco-reports from 2011 and 2016, and twenty-eight and a half hours of semi-directive interviews conducted with twenty-four journalists in late 2016 - early 2017 on the social and professional conditions of production of these reports. At the end of the triple exploration of this corpus, the triptych "population - public authorities - journalist" emerged as the key to understanding the cultural models in question. The study succeeded in demonstrating that these cultural models imply a double game of omission of certain anthropic causes and certain effects of the degradation of the human habitat. They are stable and sustainable between 2011, 2016 and 2017. The journalist has assimilated them among others with his parents and during his school and academic curriculum. They are of the order of "constraints or potentialities that are anchored in the system of action - family, friends or professional - in which [the journalist is involved]" (Alami, et. al., 2009: 14). These constraints and potentialities are present in the journalist's personal and professional experiences with the environment, which include the reasons for writing the journalistic information being analyzed. Linked to these experiences and underlying this information, the cultural models identified in this study are highly dysfunctional, since they involve more factors that do not serve to sanitize the human habitat. But, in the meantime, they have a weak tendency to mobilize certain individual and collective actions that ensure public health. As a result, in relation to the population, which is directly affected by the urban sanitation problem and sometimes struggles in its own way to get out of it, and the public authorities, which are supposed to remedy it in an effective and sustainable way, the journalist defines himself as an urban sanitation watchdog. In this position, he has only one goal: to raise awareness so that the environment is cleaned up from anarchic constructions, waste, floods, erosion and pollution.
Membres du jury
Professeur Andrea Catellani (UCLouvain, Belgique), co-promoteur et secrétaire
Professeur émérite Philippe Marion (UCLouvain, Belgique), co-promoteur
Professeur émérite Marc Lits (UCLouvain, Belgique), président du jury
Maître de conférences Béatrice Jalenques-Vigouroux (INSA Toulouse, France), membre
Maître de conférences Marie Fierens (ULB, Belgique), membre -
Chloé Colpé - Adolescence : la fabrique des héros. Une socio-anthropologie du dispositif "Avoir 20 ans en 2015", projet mené par l'artiste Wajdi Mouawad dans le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture09 Oct09 Oct...
Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Chloé Colpé
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Adolescence : la fabrique des héros. Une socio-anthropologie du dispositif "Avoir 20 ans en 2015", projet mené par l'artiste Wajdi Mouawad dans le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture
Résumé
En janvier 2011, Wajdi Mouawad, artiste et metteur en scène au rayonnement international, associé à Mons 2015 dans le cadre de l’année européenne de la culture, a proposé un projet inédit à cinquante adolescents originaires de Belgique, de France et du Canada : de quinze à vingt ans, voyager ensemble une semaine par an dans le monde, fréquenter les théâtres de leurs villes d’origine, se poser « les questions brûlantes » relatives à l’adolescence avec pour ambition d’« apprendre à penser par soi-même ».
La chercheuse a, pendant cinq années, accompagné, observé cette expérience avec pour objectif d’analyser au plus près le dispositif de médiation mis en place par l'artiste et de comprendre comment les vingt adolescents belges du projet l’ont vécu et discuté.
La lecture compréhensive de cette “aventure” proposée par la chercheuse s’articule autour de la notion d’épreuve (épreuve à soi, aux autres, à l’école, à la famille, à la société). La chercheuse a, entre autres, pratiqué l'observation ethnographique des cinq voyages (2011-2015) et développé une démarche compréhensive, inductive et originale en réalisant des entretiens individuels annuels filmés (2011-2017) qui ont constitué la matière de 20 portraits documentaires et d’un film concluant cette odyssée.
En croisant les approches et les horizons disciplinaires, la chercheuse a produit, au travers d’une méthode fondée sur l’écoute et la rencontre, un savoir réflexif et co-construit avec les 20 acteurs, qui s’inscrit au cœur des sciences de l’information et de la communication qui contribue au corpus théorique des sciences de l’information et de la communication.
Abstract
In January 2011, internationally renowned artist and director Wajdi Mouawad, who was involved in Mons 2015 and its year as European Capital of Culture, came up with an unprecedented project aimed at fifty teenagers from Belgium, France and Canada: between the ages of fifteen and twenty, they were given the chance to spend one week a year travelling around the world, visiting theatres in their home towns, and asking themselves some “burning questions” about adolescence, with a view to “learning to think for themselves”.
The researcher has spent five years with them, observing the experience in order to take a close-up, in-depth look at the process organised by the artist, finding out how the twenty Belgian teenagers involved in the project got on and what they talked about.
The comprehensive analysis of this “adventure” produced by the researcher is based on the notion of challenge (challenging yourself, others, school your family and society). Among other things, the researcher carried out an ethnographic observation of five trips (2011-2015) and developed a comprehensive, inductive and original approach, filming one-to-one interviews each year (2011-2017), which form the substance of 20 documentary portraits and a film that brings this odyssey to an end.
Using a range of different approaches and disciplines, the researcher has adopted a method based on listening and talking to produce a reflective, collaborative end product with the 20 subjects. The project fits in perfectly with information and communication sciences, contributing to the body of theory for these fields.
Membres du jury
Présidente : Suzanne Kieffer Université catholique de Louvain
Secrétaire : Benoît Grevisse Université catholique de Louvain
Promoteurs: Philippe Scieur Université catholique de Louvain et Gérard Derèze Université catholique de Louvain
Autres membres du Jury :
Christine Dole-Louveau de la Guignerave Université d’Evry, France
Magali Sizorn Université d’Evry, FranceEn savoir plusChloé Colpé - Adolescence : la fabrique des héros. Une socio-anthropologie du dispositif "Avoir 20 ans en 2015", projet mené par l'artiste Wajdi Mouawad dans le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture09 Oct09 Oct...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Chloé Colpé
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Adolescence : la fabrique des héros. Une socio-anthropologie du dispositif "Avoir 20 ans en 2015", projet mené par l'artiste Wajdi Mouawad dans le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture
Résumé
En janvier 2011, Wajdi Mouawad, artiste et metteur en scène au rayonnement international, associé à Mons 2015 dans le cadre de l’année européenne de la culture, a proposé un projet inédit à cinquante adolescents originaires de Belgique, de France et du Canada : de quinze à vingt ans, voyager ensemble une semaine par an dans le monde, fréquenter les théâtres de leurs villes d’origine, se poser « les questions brûlantes » relatives à l’adolescence avec pour ambition d’« apprendre à penser par soi-même ».
La chercheuse a, pendant cinq années, accompagné, observé cette expérience avec pour objectif d’analyser au plus près le dispositif de médiation mis en place par l'artiste et de comprendre comment les vingt adolescents belges du projet l’ont vécu et discuté.
La lecture compréhensive de cette “aventure” proposée par la chercheuse s’articule autour de la notion d’épreuve (épreuve à soi, aux autres, à l’école, à la famille, à la société). La chercheuse a, entre autres, pratiqué l'observation ethnographique des cinq voyages (2011-2015) et développé une démarche compréhensive, inductive et originale en réalisant des entretiens individuels annuels filmés (2011-2017) qui ont constitué la matière de 20 portraits documentaires et d’un film concluant cette odyssée.
En croisant les approches et les horizons disciplinaires, la chercheuse a produit, au travers d’une méthode fondée sur l’écoute et la rencontre, un savoir réflexif et co-construit avec les 20 acteurs, qui s’inscrit au cœur des sciences de l’information et de la communication qui contribue au corpus théorique des sciences de l’information et de la communication.
Abstract
In January 2011, internationally renowned artist and director Wajdi Mouawad, who was involved in Mons 2015 and its year as European Capital of Culture, came up with an unprecedented project aimed at fifty teenagers from Belgium, France and Canada: between the ages of fifteen and twenty, they were given the chance to spend one week a year travelling around the world, visiting theatres in their home towns, and asking themselves some “burning questions” about adolescence, with a view to “learning to think for themselves”.
The researcher has spent five years with them, observing the experience in order to take a close-up, in-depth look at the process organised by the artist, finding out how the twenty Belgian teenagers involved in the project got on and what they talked about.
The comprehensive analysis of this “adventure” produced by the researcher is based on the notion of challenge (challenging yourself, others, school your family and society). Among other things, the researcher carried out an ethnographic observation of five trips (2011-2015) and developed a comprehensive, inductive and original approach, filming one-to-one interviews each year (2011-2017), which form the substance of 20 documentary portraits and a film that brings this odyssey to an end.
Using a range of different approaches and disciplines, the researcher has adopted a method based on listening and talking to produce a reflective, collaborative end product with the 20 subjects. The project fits in perfectly with information and communication sciences, contributing to the body of theory for these fields.
Membres du jury
Présidente : Suzanne Kieffer Université catholique de Louvain
Secrétaire : Benoît Grevisse Université catholique de Louvain
Promoteurs: Philippe Scieur Université catholique de Louvain et Gérard Derèze Université catholique de Louvain
Autres membres du Jury :
Christine Dole-Louveau de la Guignerave Université d’Evry, France
Magali Sizorn Université d’Evry, France -
 Camille Tilleul - Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique10 Sep10 Sep...
Camille Tilleul - Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique10 Sep10 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Camille Tilleul
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique ».
Résumé
Ma recherche doctorale vise à dépasser l’hypothèse communément établie que c’est simplement en ayant accès et en manipulant fréquemment les médias que les jeunes développent des compétences et des usages vertueux de ceux-ci. Les chercheurs du domaine de la littératie médiatique et de l’éducation aux médias montrent en effet qu’il est nécessaire de s’intéresser aux usages et aux motivations qu’ont les individus à pratiquer ces médias et au développement de différents niveaux de compétences médiatiques que cela permet.
Ma recherche va donc en ce sens, et interroge les relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux sociaux et le développement de leurs compétences en littératie médiatique. Plus particulièrement, elle fait l’hypothèse que plus que la fréquence, c’est la diversité des pratiques sur les réseaux sociaux qui soutient le développement de compétences médiatiques.
J’ai effectué cette recherche en deux temps : premièrement, j’ai mené une enquête quantitative via un questionnaire en ligne interrogeant 350 jeunes adultes belges. Les résultats montrent qu’il existe cinq profils d’usages sur les réseaux sociaux et que ces profils obtiennent des résultats significativement différents lorsqu’ils sont interrogés sur leurs compétences médiatiques.
La seconde phase de ma recherche a consisté en l’analyse de dix entretiens menés auprès de personnes composant les cinq profils d’usages. Elle permet de venir éclairer ces résultats et met en lumière plusieurs types de pratiques. Les résultats montrent, d’une part, comment la diversité des activités de réception et notamment le fait d’adopter une posture curieuse et un intérêt pour des sujets qui dépassent la sphère de l’amitié soutient le développement de compétences en littératie médiatique. D’autre part, ce n’est pas la diversité, mais bien l’engagement des individus dans leurs productions au sein de communautés d’intérêts qui soutient également le développement de compétences médiatiques.
Membres du jury
Pierre Fastrez (promoteur et secrétaire), Université catholique de Louvain ;
Anne-Sophie Collard, Université de Namur ;
Julie Denouël, Université Rennes 2, France ;
Normand Landry, Université Téluq, Canada ;
Philippe Verhaegen (président), Université catholique de Louvain.En savoir plus Camille Tilleul - Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique10 Sep10 Sep...
Camille Tilleul - Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique10 Sep10 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Camille Tilleul
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences en littératie médiatique ».
Résumé
Ma recherche doctorale vise à dépasser l’hypothèse communément établie que c’est simplement en ayant accès et en manipulant fréquemment les médias que les jeunes développent des compétences et des usages vertueux de ceux-ci. Les chercheurs du domaine de la littératie médiatique et de l’éducation aux médias montrent en effet qu’il est nécessaire de s’intéresser aux usages et aux motivations qu’ont les individus à pratiquer ces médias et au développement de différents niveaux de compétences médiatiques que cela permet.
Ma recherche va donc en ce sens, et interroge les relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux sociaux et le développement de leurs compétences en littératie médiatique. Plus particulièrement, elle fait l’hypothèse que plus que la fréquence, c’est la diversité des pratiques sur les réseaux sociaux qui soutient le développement de compétences médiatiques.
J’ai effectué cette recherche en deux temps : premièrement, j’ai mené une enquête quantitative via un questionnaire en ligne interrogeant 350 jeunes adultes belges. Les résultats montrent qu’il existe cinq profils d’usages sur les réseaux sociaux et que ces profils obtiennent des résultats significativement différents lorsqu’ils sont interrogés sur leurs compétences médiatiques.
La seconde phase de ma recherche a consisté en l’analyse de dix entretiens menés auprès de personnes composant les cinq profils d’usages. Elle permet de venir éclairer ces résultats et met en lumière plusieurs types de pratiques. Les résultats montrent, d’une part, comment la diversité des activités de réception et notamment le fait d’adopter une posture curieuse et un intérêt pour des sujets qui dépassent la sphère de l’amitié soutient le développement de compétences en littératie médiatique. D’autre part, ce n’est pas la diversité, mais bien l’engagement des individus dans leurs productions au sein de communautés d’intérêts qui soutient également le développement de compétences médiatiques.
Membres du jury
Pierre Fastrez (promoteur et secrétaire), Université catholique de Louvain ;
Anne-Sophie Collard, Université de Namur ;
Julie Denouël, Université Rennes 2, France ;
Normand Landry, Université Téluq, Canada ;
Philippe Verhaegen (président), Université catholique de Louvain. -
 Dioso Priscilla Kasongo - De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique25 Aug25 Aug...
Dioso Priscilla Kasongo - De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique25 Aug25 Aug...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Dioso Priscilla Kasongo
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’Information et de la Communication
« De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique »
Abstract
Transition phenomena such as migration can result in identity and language instabilities among
individuals involved. To regulate those, migrants can build strategies. These are the strategies
that we focused on during our doctoral research.
In this study, we analysed language practices of the youth from the second generation of
congolese migration (D.R.Congo) in Belgium, in order to identify the identity strategies they set
up, and to construct profiles corresponding to those strategies.
Essentially based on intercultural communication, but in a multidisciplinary perspective, our
research has also tapped into identity constructivism, variationist sociolinguistics, and migration
sociology.
Thus, with a qualitative approach mainly inspired by the Grounded Theory Method, we
interviewed, in semi-structured interviews, the youth from the second generation of Congolese
migration in Belgium established in Brussels.
After two fields, we managed to build two models. The first model was empirical and based on
different positive and negative modalities of identity construction (Congolese, multicultural and
Belgian). The second model was theoretical and based on the various state-of-the-art concepts
(identity strategies, language practices and discursive registers, intercultural competences and
migration studies).
After comparing our two models, we have constructed an intercultural identity construction
scheme, in which the Belgian-Congolese identity is central and broken down into several sub
profiles (radical or multicultural, convergent or divergent). Finally, although being only
intercultural in the process, we considered that globally, this Belgian-Congolese identity was
nevertheless deployed in a multicultural way.Résumé
Les phénomènes de transition tels que la migration peuvent amener à des perturbations
identitaires et langagières chez les individus concernés. Afin de les gérer, les migrants peuvent
construire des stratégies. Ce sont ces stratégies qui ont été au cœur de nos recherches doctorales.
Dans cette étude, nous avons analysé les pratiques langagières des jeunes de la deuxième
génération de migration congolaise (R.D. Congo) en Belgique, afin d’identifier les stratégies
identitaires qu’ils mettent en place, et d’établir les profils correspondants à ces stratégies.
Reposant essentiellement sur la communication interculturelle, dans une optique pluridisciplinaire, notre
recherche a également puisé dans le constructivisme identitaire, de la sociolinguistique variationniste, et la
sociologie des migrations.
Ainsi, avec une approche qualitative principalement inspirée de la méthode de théorisation ancrée, nous
avons interrogé, en entretiens semi-directifs, des jeunes de la deuxième génération de migration congolaise
établis dans la région de Bruxelles-Capitale.
Au bout de deux terrains, nous avons construit deux modèles. Le premier modèle était empirique et reposait
sur différentes modalités positives et négatives de construction identitaire (congolaise, multiculturelle et
belge). Le deuxième modèle était théorique et reposait quant à lui sur les différents concepts issus de l’état
de l’art (stratégies identitaires, pratiques langagières et registres discursifs, compétences interculturelles et
études migratoires).
Après avoir confronté nos modèles empiriques et théoriques, nous sommes parvenue à établie un schéma
de construction identitaire interculturelle, dans lequel l’identité belgo-congolaise est centrale et déclinée en
plusieurs sous-profils (radicaux ou multiculturels, convergents ou divergents). En définitive, bien que n’étant
interculturelle que dans le processus, nous avons considéré que cette identité belgo-congolaise était
toutefois déployée de manière globalement multiculturelle.Membres du jury
Professeur Alain Reyniers (UCLouvain), co-promoteur
Professeure Jacinthe Mazzocchetti (UCLouvain), co-promotrice
Professeur Marc Lits (UCLouvain)
Professeur Hilaire Lumbala Mbiye (Université Catholique du Congo)
Professeure Aimée-Danielle Lezou-Koffi (Université Félix Houphouët-Boigny)
Professeure Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury et secrétaire
En savoir plus Dioso Priscilla Kasongo - De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique25 Aug25 Aug...
Dioso Priscilla Kasongo - De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique25 Aug25 Aug...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Dioso Priscilla Kasongo
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’Information et de la Communication
« De l’identité belgo-congolaise. Pratiques langagières métissées et compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique »
Abstract
Transition phenomena such as migration can result in identity and language instabilities among
individuals involved. To regulate those, migrants can build strategies. These are the strategies
that we focused on during our doctoral research.
In this study, we analysed language practices of the youth from the second generation of
congolese migration (D.R.Congo) in Belgium, in order to identify the identity strategies they set
up, and to construct profiles corresponding to those strategies.
Essentially based on intercultural communication, but in a multidisciplinary perspective, our
research has also tapped into identity constructivism, variationist sociolinguistics, and migration
sociology.
Thus, with a qualitative approach mainly inspired by the Grounded Theory Method, we
interviewed, in semi-structured interviews, the youth from the second generation of Congolese
migration in Belgium established in Brussels.
After two fields, we managed to build two models. The first model was empirical and based on
different positive and negative modalities of identity construction (Congolese, multicultural and
Belgian). The second model was theoretical and based on the various state-of-the-art concepts
(identity strategies, language practices and discursive registers, intercultural competences and
migration studies).
After comparing our two models, we have constructed an intercultural identity construction
scheme, in which the Belgian-Congolese identity is central and broken down into several sub
profiles (radical or multicultural, convergent or divergent). Finally, although being only
intercultural in the process, we considered that globally, this Belgian-Congolese identity was
nevertheless deployed in a multicultural way.Résumé
Les phénomènes de transition tels que la migration peuvent amener à des perturbations
identitaires et langagières chez les individus concernés. Afin de les gérer, les migrants peuvent
construire des stratégies. Ce sont ces stratégies qui ont été au cœur de nos recherches doctorales.
Dans cette étude, nous avons analysé les pratiques langagières des jeunes de la deuxième
génération de migration congolaise (R.D. Congo) en Belgique, afin d’identifier les stratégies
identitaires qu’ils mettent en place, et d’établir les profils correspondants à ces stratégies.
Reposant essentiellement sur la communication interculturelle, dans une optique pluridisciplinaire, notre
recherche a également puisé dans le constructivisme identitaire, de la sociolinguistique variationniste, et la
sociologie des migrations.
Ainsi, avec une approche qualitative principalement inspirée de la méthode de théorisation ancrée, nous
avons interrogé, en entretiens semi-directifs, des jeunes de la deuxième génération de migration congolaise
établis dans la région de Bruxelles-Capitale.
Au bout de deux terrains, nous avons construit deux modèles. Le premier modèle était empirique et reposait
sur différentes modalités positives et négatives de construction identitaire (congolaise, multiculturelle et
belge). Le deuxième modèle était théorique et reposait quant à lui sur les différents concepts issus de l’état
de l’art (stratégies identitaires, pratiques langagières et registres discursifs, compétences interculturelles et
études migratoires).
Après avoir confronté nos modèles empiriques et théoriques, nous sommes parvenue à établie un schéma
de construction identitaire interculturelle, dans lequel l’identité belgo-congolaise est centrale et déclinée en
plusieurs sous-profils (radicaux ou multiculturels, convergents ou divergents). En définitive, bien que n’étant
interculturelle que dans le processus, nous avons considéré que cette identité belgo-congolaise était
toutefois déployée de manière globalement multiculturelle.Membres du jury
Professeur Alain Reyniers (UCLouvain), co-promoteur
Professeure Jacinthe Mazzocchetti (UCLouvain), co-promotrice
Professeur Marc Lits (UCLouvain)
Professeur Hilaire Lumbala Mbiye (Université Catholique du Congo)
Professeure Aimée-Danielle Lezou-Koffi (Université Félix Houphouët-Boigny)
Professeure Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury et secrétaire
-
 Daisy Boujawdeh - Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban02 Jun02 Jun...
Daisy Boujawdeh - Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban02 Jun02 Jun...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Daisy BOUJAWDEH
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
« Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban ».
Abstract
The open question of cultural diversity in Lebanon, often creates difficulties in the cooperation and interaction between individual members of the various lebanese religious communities, particularly in the absence of any official and national policy towards intercultural issues.
This doctoral thesis delves into the intercultural communication through the scheme of arts education to promote intercultural competences and effective communication for students in a culturally diverse academic environment.
The first part of the thesis explore the history of intercultural communication and the intercultural communication theories that resulted, which led to the selection of the theory used in this study being the theory of uncertainty and anxiety management by W.B. Gudykunst.
The second part of the thesis focuses on establishing and introducing an academic program founded on both, multicultural and arts education, leading the change towards an intercultural education at the students and teachers’ levels in the program.
The study is based on research questions that explores the relationship between the students perceptions of anxiety and uncertainty faced during their first interactions in a university having an intercultural environment and the establishment of an intercultural and artistic education in the graphic design department, as well as its effect on the management of anxiety and uncertainty and the acquisition of intercultural competence.
Résumé
La question de la diversité culturelle est une question constamment ouverte au Liban, mais en l’absence de toute politique nationale officielle envers les questions interculturelles, il y a souvent des difficultés dans la coopération et dans l’interaction entre les individus membres des nombreuses communautés confessionnelles libanaises.
Dans cette thèse de doctorat, nous étudions la communication interculturelle à travers le schéma de l’enseignement artistique pour favoriser la compétence interculturelle et la communication efficace des étudiants dans un milieu universitaire composé d’une diversité culturelle.
Dans la première partie de la thèse, nous avons mené une étude sur l’historique de la communication interculturelle, les théories de la communication interculturelle en général pour par la suite choisir celle utilisée dans l’étude : la théorie de la gestion de l’incertitude et l’anxiété de W. B. Gudykunst.
Dans la deuxième partie de la thèse, nous avons travaillé sur l’instauration d’un dispositif académique résultant de l’enseignement multiculturel et l’enseignement artistique qui nous a permis de mener le changement vers un apprentissage interculturel au niveau des enseignants et des étudiants de la licence étudiée.
L’étude repose sur des questions de recherche qui explorent la relation entre : Les perceptions des étudiants face à l’anxiété et l’incertitude des premières interactions comme leur arrivée dans un milieu interculturel à l’université, et l’instauration d’u enseignement artistique interculturel dans le département des arts graphiques ainsi que son effet sur le mécanisme de gestion de l’anxiété et de l’incertitude et sur l’acquisition de la compétence interculturelle.
Membres du jury
Professeur Alain Reyniers (UCL), co-promoteur et secrétaire
Professeur Sarah Sepulchre (UCL), co-promotrice
Professeur Marc Lits (UCL)
Professeur Vincent Legrand (UCL)
Professeur Saouma BouJaoude (American University of Beirut)
Professeur Andrea Catellani (UCL), président du juryEn savoir plus Daisy Boujawdeh - Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban02 Jun02 Jun...
Daisy Boujawdeh - Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban02 Jun02 Jun...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Daisy BOUJAWDEH
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
« Communication interculturelle et enseignement artistique : Le cas de l’Université Antonine au Liban ».
Abstract
The open question of cultural diversity in Lebanon, often creates difficulties in the cooperation and interaction between individual members of the various lebanese religious communities, particularly in the absence of any official and national policy towards intercultural issues.
This doctoral thesis delves into the intercultural communication through the scheme of arts education to promote intercultural competences and effective communication for students in a culturally diverse academic environment.
The first part of the thesis explore the history of intercultural communication and the intercultural communication theories that resulted, which led to the selection of the theory used in this study being the theory of uncertainty and anxiety management by W.B. Gudykunst.
The second part of the thesis focuses on establishing and introducing an academic program founded on both, multicultural and arts education, leading the change towards an intercultural education at the students and teachers’ levels in the program.
The study is based on research questions that explores the relationship between the students perceptions of anxiety and uncertainty faced during their first interactions in a university having an intercultural environment and the establishment of an intercultural and artistic education in the graphic design department, as well as its effect on the management of anxiety and uncertainty and the acquisition of intercultural competence.
Résumé
La question de la diversité culturelle est une question constamment ouverte au Liban, mais en l’absence de toute politique nationale officielle envers les questions interculturelles, il y a souvent des difficultés dans la coopération et dans l’interaction entre les individus membres des nombreuses communautés confessionnelles libanaises.
Dans cette thèse de doctorat, nous étudions la communication interculturelle à travers le schéma de l’enseignement artistique pour favoriser la compétence interculturelle et la communication efficace des étudiants dans un milieu universitaire composé d’une diversité culturelle.
Dans la première partie de la thèse, nous avons mené une étude sur l’historique de la communication interculturelle, les théories de la communication interculturelle en général pour par la suite choisir celle utilisée dans l’étude : la théorie de la gestion de l’incertitude et l’anxiété de W. B. Gudykunst.
Dans la deuxième partie de la thèse, nous avons travaillé sur l’instauration d’un dispositif académique résultant de l’enseignement multiculturel et l’enseignement artistique qui nous a permis de mener le changement vers un apprentissage interculturel au niveau des enseignants et des étudiants de la licence étudiée.
L’étude repose sur des questions de recherche qui explorent la relation entre : Les perceptions des étudiants face à l’anxiété et l’incertitude des premières interactions comme leur arrivée dans un milieu interculturel à l’université, et l’instauration d’u enseignement artistique interculturel dans le département des arts graphiques ainsi que son effet sur le mécanisme de gestion de l’anxiété et de l’incertitude et sur l’acquisition de la compétence interculturelle.
Membres du jury
Professeur Alain Reyniers (UCL), co-promoteur et secrétaire
Professeur Sarah Sepulchre (UCL), co-promotrice
Professeur Marc Lits (UCL)
Professeur Vincent Legrand (UCL)
Professeur Saouma BouJaoude (American University of Beirut)
Professeur Andrea Catellani (UCL), président du jury -
 Elier Gonzalez Martinez - Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle04 May04 May...
Elier Gonzalez Martinez - Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle04 May04 May...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Elier Gonzalez Martinez
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle
Résumé
Cette recherche analyse les dispositifs de médiation culturelle créés et développés par des projets socioculturels communautaires dans les quartiers périphériques de La Havane, Cuba. On est parti de l’hypothèse que ces médiations ont conduit à une autre dimension du territoire basée sur l’art : une communauté culturelle. L’approche méthodologique utilisée était mixte, appliquant des méthodes et techniques de l’approche qualitative et quantitative. Parmi les principaux résultats se trouvent : (1) la coexistence d’une logique top-down, typique du processus de démocratisation culturelle du pays, et de propositions émergentes avec une logique bottom-up comme formes de démocratie culturelle sur le territoire. (2) Sur les médiations culturelles : l’expérience esthétique vécue varie en fonction des années de participation ; dans les projets qui font de la musique et de la danse la principale manifestation artistique, la reconnaissance de la dimension participative et axiologique comme médiation culturelle n’est pas généralisable ; le sentiment d’appartenance au territoire s’est consolidé avec la participation au projet. (3) Enfin, l’idée d’une communauté culturelle, basée sur les dimensions des médiations culturelles, n’est pas si évidente dans les projets qui ont élargi ses horizons et ses objectifs d’action par rapport à ceux qui maintiennent son statut de quartier ou de projet communautaire.
Abstract
This research analyses the cultural mediation devices created and developed by community sociocultural projects in peripheral neighborhoods of Havana, Cuba. The initial hypothesis considered that these mediations led to another dimension of territory based on art: a cultural community. The methodological approach was mixed, applying qualitative and quantitative research methods and techniques. The main results were: (1) the coexistence of a top-down logic, typical of the country’s cultural democratization process, and emerging proposals with a bottom-up logic as forms of cultural democracy in the territory. (2) On cultural mediations: the aesthetic experience varies depending on the years of participation; in projects that develop music and dance as the main artistic manifestation, the recognition of the participative and axiological dimension as cultural mediation cannot be generalized; the feeling of belonging to the territory was consolidated with participation in the community sociocultural project. (3) Finally, the idea of cultural community, based on the dimensions of the cultural mediations, is not so evident in those projects that broadened its horizons and action goals compared to those that retain its status as a neighbourhood or community project.
Membres du jury
Président : Professeur Sébastien Fevry UCLouvain
Promoteur et Secrétaire: Professeur Philippe Scieur UCLouvain
Promotrice : Professeure Sarah Sepulchre UCLouvain
Membre UcLouvain: Professeur Damien Vaneste UCLouvain
Membre extérieur: Dr. Xavier Canonne Directeur du Musée de la Photographie (Belgique)En savoir plus Elier Gonzalez Martinez - Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle04 May04 May...
Elier Gonzalez Martinez - Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle04 May04 May...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Elier Gonzalez Martinez
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Les enjeux du développement culturel à La Havane, Cuba : les projets socioculturels et les nouvelles formes de médiation culturelle
Résumé
Cette recherche analyse les dispositifs de médiation culturelle créés et développés par des projets socioculturels communautaires dans les quartiers périphériques de La Havane, Cuba. On est parti de l’hypothèse que ces médiations ont conduit à une autre dimension du territoire basée sur l’art : une communauté culturelle. L’approche méthodologique utilisée était mixte, appliquant des méthodes et techniques de l’approche qualitative et quantitative. Parmi les principaux résultats se trouvent : (1) la coexistence d’une logique top-down, typique du processus de démocratisation culturelle du pays, et de propositions émergentes avec une logique bottom-up comme formes de démocratie culturelle sur le territoire. (2) Sur les médiations culturelles : l’expérience esthétique vécue varie en fonction des années de participation ; dans les projets qui font de la musique et de la danse la principale manifestation artistique, la reconnaissance de la dimension participative et axiologique comme médiation culturelle n’est pas généralisable ; le sentiment d’appartenance au territoire s’est consolidé avec la participation au projet. (3) Enfin, l’idée d’une communauté culturelle, basée sur les dimensions des médiations culturelles, n’est pas si évidente dans les projets qui ont élargi ses horizons et ses objectifs d’action par rapport à ceux qui maintiennent son statut de quartier ou de projet communautaire.
Abstract
This research analyses the cultural mediation devices created and developed by community sociocultural projects in peripheral neighborhoods of Havana, Cuba. The initial hypothesis considered that these mediations led to another dimension of territory based on art: a cultural community. The methodological approach was mixed, applying qualitative and quantitative research methods and techniques. The main results were: (1) the coexistence of a top-down logic, typical of the country’s cultural democratization process, and emerging proposals with a bottom-up logic as forms of cultural democracy in the territory. (2) On cultural mediations: the aesthetic experience varies depending on the years of participation; in projects that develop music and dance as the main artistic manifestation, the recognition of the participative and axiological dimension as cultural mediation cannot be generalized; the feeling of belonging to the territory was consolidated with participation in the community sociocultural project. (3) Finally, the idea of cultural community, based on the dimensions of the cultural mediations, is not so evident in those projects that broadened its horizons and action goals compared to those that retain its status as a neighbourhood or community project.
Membres du jury
Président : Professeur Sébastien Fevry UCLouvain
Promoteur et Secrétaire: Professeur Philippe Scieur UCLouvain
Promotrice : Professeure Sarah Sepulchre UCLouvain
Membre UcLouvain: Professeur Damien Vaneste UCLouvain
Membre extérieur: Dr. Xavier Canonne Directeur du Musée de la Photographie (Belgique) -
 Gervais Cwako Monkam - La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne27 Apr27 Apr...
Gervais Cwako Monkam - La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne27 Apr27 Apr...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Monsieur Gervais Cwako Monkam
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne »
Abstract
Today’s rise of corporate communication depends on the ability of companies to be proficient in their communication techniques, of which the expectations differ in competitive markets at local and international levels. It is therefore for companies, by reference to coherent communication techniques to build a brand image that positions them sustainably in the minds of their respective audiences. A large number of publications dealing with corporate image and its strategic importance, give little attention to external image. The present research aims to contribute to filling this gap by offering a reading of corporate communication that takes into account local socio-cultural values, and by developing a model that explains the process of the external image formation and its evaluation in terms of performance. The challenge of our research is to demonstrate that the study of the external environment of companies, brings added value to the corporate image, which then develops consistent identity building strategies based on the expectations and demands of stakeholders. The study of a company’s external image as proposed is therefore related to the evolution of contemporary entrepreneurial thinking and offers new ways of approaching a company whose social legitimacy is increasingly contested.
Résumé
L’essor de la communication des entreprises passerait aujourd’hui par la capacité de celles-ci à maîtriser leurs techniques de communication corporate, lesquelles différencient les attendus sur les marchés concurrentiels qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Il s’agira donc pour les entreprises de construire, à l'aune de techniques communicationnelles cohérentes, leur capital image qui les positionne durablement et en adéquation avec leurs actions, dans l’esprit de leurs publics respectifs. De nombreux ouvrages traitant de l’image corporate et de son importance stratégique, accordent peu de place à l’image externe de cette dernière. Nous entendons par la présente recherche, contribuer à notre niveau, à combler cette lacune. D’une part, en proposant une lecture de la communication corporate qui tient compte des valeurs socioculturelles locales, et d’autre part, en élaborant un modèle explicatif du processus de formation de l’image externe et de son évaluation sur le plan performatif. Le propos étant de démontrer que l’étude de l’environnement externe des entreprises, apporte une valeur ajoutée au diagnostic d’image, ce qui a dès lors pour effet de bâtir des stratégies de construction identitaire conséquentes, entendu qu’elles se sont appuyées sur les attentes et les demandes des parties prenantes. L’étude de l’image externe d’entreprise que nous proposons s’inscrit donc dans l’évolution des modes de pensée entrepreneuriale contemporaine et s’intègre aux nouveaux modes d’approche de l’entreprise dont la légitimité sociale est de plus en plus contestée.
Membres du jury
Pr. Damien RENARD (Secrétaire / UCLouvain)
Pr. François LAMBOTTE (Président / UCLouvain)
Pr. Thierry LIBAERT (Membre / EDF, CESE (Conseil Economique et Social de l’Union Européenne)
Pr. Patrice MBIANDA (UCAC/ Université de Yaoundé 1 – Cameroun)
Pr. Andréa CATELLANI (Promoteur/UCLouvain)En savoir plus Gervais Cwako Monkam - La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne27 Apr27 Apr...
Gervais Cwako Monkam - La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne27 Apr27 Apr...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Monsieur Gervais Cwako Monkam
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« La contribution de la communication corporate dans la construction de l’image des entreprises multinationales en Afrique subsaharienne »
Abstract
Today’s rise of corporate communication depends on the ability of companies to be proficient in their communication techniques, of which the expectations differ in competitive markets at local and international levels. It is therefore for companies, by reference to coherent communication techniques to build a brand image that positions them sustainably in the minds of their respective audiences. A large number of publications dealing with corporate image and its strategic importance, give little attention to external image. The present research aims to contribute to filling this gap by offering a reading of corporate communication that takes into account local socio-cultural values, and by developing a model that explains the process of the external image formation and its evaluation in terms of performance. The challenge of our research is to demonstrate that the study of the external environment of companies, brings added value to the corporate image, which then develops consistent identity building strategies based on the expectations and demands of stakeholders. The study of a company’s external image as proposed is therefore related to the evolution of contemporary entrepreneurial thinking and offers new ways of approaching a company whose social legitimacy is increasingly contested.
Résumé
L’essor de la communication des entreprises passerait aujourd’hui par la capacité de celles-ci à maîtriser leurs techniques de communication corporate, lesquelles différencient les attendus sur les marchés concurrentiels qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Il s’agira donc pour les entreprises de construire, à l'aune de techniques communicationnelles cohérentes, leur capital image qui les positionne durablement et en adéquation avec leurs actions, dans l’esprit de leurs publics respectifs. De nombreux ouvrages traitant de l’image corporate et de son importance stratégique, accordent peu de place à l’image externe de cette dernière. Nous entendons par la présente recherche, contribuer à notre niveau, à combler cette lacune. D’une part, en proposant une lecture de la communication corporate qui tient compte des valeurs socioculturelles locales, et d’autre part, en élaborant un modèle explicatif du processus de formation de l’image externe et de son évaluation sur le plan performatif. Le propos étant de démontrer que l’étude de l’environnement externe des entreprises, apporte une valeur ajoutée au diagnostic d’image, ce qui a dès lors pour effet de bâtir des stratégies de construction identitaire conséquentes, entendu qu’elles se sont appuyées sur les attentes et les demandes des parties prenantes. L’étude de l’image externe d’entreprise que nous proposons s’inscrit donc dans l’évolution des modes de pensée entrepreneuriale contemporaine et s’intègre aux nouveaux modes d’approche de l’entreprise dont la légitimité sociale est de plus en plus contestée.
Membres du jury
Pr. Damien RENARD (Secrétaire / UCLouvain)
Pr. François LAMBOTTE (Président / UCLouvain)
Pr. Thierry LIBAERT (Membre / EDF, CESE (Conseil Economique et Social de l’Union Européenne)
Pr. Patrice MBIANDA (UCAC/ Université de Yaoundé 1 – Cameroun)
Pr. Andréa CATELLANI (Promoteur/UCLouvain)
-
 Rémy Bersipont - Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique30 Sep30 Sep...
Rémy Bersipont - Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique30 Sep30 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Rémy Bersipont
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique »
Pour assister à la soutenance, l'inscription est obligatoire jusqu'à la limite des places disponibles.
Merci adresser votre demande d’inscription à remy.bersipont@uclouvain.be avant le 28 septembre.Résumé
Notre recherche porte sur les rapports entre les dimensions politico-culturelle et économique des médias (Le Floch et Sonnac, 2013) (McChesney, 2013). Elle s’intéresse à ce sujet, en étudiant la diversification et les modèles d’affaires de trois entreprises de presse écrite quotidienne payante (IPM, Rossel et Les Éditions de L’Avenir) réalisant leurs activités originelles sur le petit marché belge francophone.
En nous appuyant sur les données issues d’une enquête documentaire (Pettigrew, 1990) et de 70 récits de vie (Bertaux, 2016) (Sanséau, 2015) avec des propriétaires de journaux, des cadres supérieurs, des marketeurs, des journalistes et des parties prenantes de l’industrie, nous montrons que, à l’ère numérique (du milieu des années 1990 à juillet 2020), les diversifications des éditeurs dans la presse écrite impliquent, selon des modalités diverses, des synergies de ressources (partage d’articles, mutualisation des ressources humaines des départements supports, utilisation d’outils informatiques communs, partage d’expériences, mutualisation des infrastructures, etc.). Leur développement dans d’autres businesses expose leurs journalistes à de potentiels conflits d’intérêts. Toutefois, lorsque des tensions s’observent avec les rédactions, l’indépendance des journalistes est préservée (Rossel et IPM). Lorsqu’elle est menacée (Les Éditions de L’Avenir), des mécanismes de défense sont mis en œuvre (grèves et utilisation du journal pour relayer les pressions, etc.). En analysant les modèles d’affaires sur le produit d’information (internet et papier), nous mettons en évidence les processus organisationnels et les contraintes managériales dans lesquels les journalistes réalisent leurs activités de production, ainsi que le rapprochement des rédactions avec la partie commerciale (marketing et régie publicitaire) de l’entreprise.
Mobilisant le postulat théorique de l’École de Grenoble selon lequel les médias constituent des marchandises culturelles (Granjon, Guyot, Magis, 2019) (Miège, 2017), ainsi que la théorie des ressources (Barney, 1991), nous proposons, finalement, d’appréhender les résultats empiriques par le biais de deux formalisations théoriques.
Membres du jury
Professeur Frédéric Antoine (UCLouvain), Promoteur
Professeur Olivier Standaert (UCLouvain), Promoteur
Professeur Benoît Grevisse (UCLouvain), Président du jury
Professeur Philippe Scieur (UCLouvain), Secrétaire du jury
Professeur Patrick Le Floch (Sciences Po Rennes)
Professeure Karin Raeymaeckers (UGhent)En savoir plus Rémy Bersipont - Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique30 Sep30 Sep...
Rémy Bersipont - Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique30 Sep30 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Rémy Bersipont
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Économie politique de la presse écrite quotidienne sur le petit marché belge francophone: diversification et modèles d’affaires à l’ère numérique »
Pour assister à la soutenance, l'inscription est obligatoire jusqu'à la limite des places disponibles.
Merci adresser votre demande d’inscription à remy.bersipont@uclouvain.be avant le 28 septembre.Résumé
Notre recherche porte sur les rapports entre les dimensions politico-culturelle et économique des médias (Le Floch et Sonnac, 2013) (McChesney, 2013). Elle s’intéresse à ce sujet, en étudiant la diversification et les modèles d’affaires de trois entreprises de presse écrite quotidienne payante (IPM, Rossel et Les Éditions de L’Avenir) réalisant leurs activités originelles sur le petit marché belge francophone.
En nous appuyant sur les données issues d’une enquête documentaire (Pettigrew, 1990) et de 70 récits de vie (Bertaux, 2016) (Sanséau, 2015) avec des propriétaires de journaux, des cadres supérieurs, des marketeurs, des journalistes et des parties prenantes de l’industrie, nous montrons que, à l’ère numérique (du milieu des années 1990 à juillet 2020), les diversifications des éditeurs dans la presse écrite impliquent, selon des modalités diverses, des synergies de ressources (partage d’articles, mutualisation des ressources humaines des départements supports, utilisation d’outils informatiques communs, partage d’expériences, mutualisation des infrastructures, etc.). Leur développement dans d’autres businesses expose leurs journalistes à de potentiels conflits d’intérêts. Toutefois, lorsque des tensions s’observent avec les rédactions, l’indépendance des journalistes est préservée (Rossel et IPM). Lorsqu’elle est menacée (Les Éditions de L’Avenir), des mécanismes de défense sont mis en œuvre (grèves et utilisation du journal pour relayer les pressions, etc.). En analysant les modèles d’affaires sur le produit d’information (internet et papier), nous mettons en évidence les processus organisationnels et les contraintes managériales dans lesquels les journalistes réalisent leurs activités de production, ainsi que le rapprochement des rédactions avec la partie commerciale (marketing et régie publicitaire) de l’entreprise.
Mobilisant le postulat théorique de l’École de Grenoble selon lequel les médias constituent des marchandises culturelles (Granjon, Guyot, Magis, 2019) (Miège, 2017), ainsi que la théorie des ressources (Barney, 1991), nous proposons, finalement, d’appréhender les résultats empiriques par le biais de deux formalisations théoriques.
Membres du jury
Professeur Frédéric Antoine (UCLouvain), Promoteur
Professeur Olivier Standaert (UCLouvain), Promoteur
Professeur Benoît Grevisse (UCLouvain), Président du jury
Professeur Philippe Scieur (UCLouvain), Secrétaire du jury
Professeur Patrick Le Floch (Sciences Po Rennes)
Professeure Karin Raeymaeckers (UGhent) -
 Drissa Kanambaye - Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.22 Sep22 Sep...
Drissa Kanambaye - Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.22 Sep22 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Drissa Kanambaye
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.
Pour assister à la soutenance, l’inscription est obligatoire jusqu'à la limite des places disponibles.
Veuillez vous inscrire par mail avant le 18 septembre en écrivant à : drissa.kanambaye@uclouvain.beLa soutenance sera également retransmise en direct et pourra être suivie sur Teams.
Abstract
In a context of great uncertainty marked by attacks, acts of violence and the destruction of cultural heritage, this thesis analyzes the involvement and mobilization of various tourism and heritage stakeholders in Mali. Using an empirical and communicational approach, this study explores the touristic, cultural and heritage potential of the Republic of Mali, which has been plunged into a security crisis for more than a decade.
Using field data and a documentary approach, this study explores three main axes by investigating the issues and challenges that constitute them: cultural heritage, tourism and heritage and cultural communication.
Résumé
Dans un contexte de grande incertitude marqué par des attentats, des actes de violence et de destruction du patrimoine culturel, cette thèse analyse l’implication et la mobilisation des divers acteurs du tourisme et du patrimoine au Mali. Mettant en œuvre une approche empirique et communicationnelle, cette étude explore les potentialités touristiques, culturelles et patrimoniales de la République du Mali plongée dans une crise sécuritaire depuis plus d’une décennie.
A travers des données de terrain et une approche documentaire, cette étude explore trois axes principaux en investiguant les problématiques et les enjeux qui les constituent : le patrimoine culturel, le tourisme et la communication patrimoniale et culturelle.
Membres du jury
Prof. Philippe Marion (UCLouvain), Président du jury
Prof. Gérard Derèze (UCLouvain), Promoteur et Secrétaire du jury
Prof. Sébastien Fevry(UCLouvain), Lecteur
Dr. Fatoumata Toure Sylla (Université de Bamako), Lectrice extérieure
Dr. Rosalie Douyon (EDC Paris Business School), Lectrice extérieureEn savoir plus Drissa Kanambaye - Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.22 Sep22 Sep...
Drissa Kanambaye - Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.22 Sep22 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Drissa Kanambaye
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
Communication touristique et patrimoine culturel au Mali dans un contexte sécuritaire (à partir de 2012) : analyse de l’implication et de la mobilisation des acteurs locaux.
Pour assister à la soutenance, l’inscription est obligatoire jusqu'à la limite des places disponibles.
Veuillez vous inscrire par mail avant le 18 septembre en écrivant à : drissa.kanambaye@uclouvain.beLa soutenance sera également retransmise en direct et pourra être suivie sur Teams.
Abstract
In a context of great uncertainty marked by attacks, acts of violence and the destruction of cultural heritage, this thesis analyzes the involvement and mobilization of various tourism and heritage stakeholders in Mali. Using an empirical and communicational approach, this study explores the touristic, cultural and heritage potential of the Republic of Mali, which has been plunged into a security crisis for more than a decade.
Using field data and a documentary approach, this study explores three main axes by investigating the issues and challenges that constitute them: cultural heritage, tourism and heritage and cultural communication.
Résumé
Dans un contexte de grande incertitude marqué par des attentats, des actes de violence et de destruction du patrimoine culturel, cette thèse analyse l’implication et la mobilisation des divers acteurs du tourisme et du patrimoine au Mali. Mettant en œuvre une approche empirique et communicationnelle, cette étude explore les potentialités touristiques, culturelles et patrimoniales de la République du Mali plongée dans une crise sécuritaire depuis plus d’une décennie.
A travers des données de terrain et une approche documentaire, cette étude explore trois axes principaux en investiguant les problématiques et les enjeux qui les constituent : le patrimoine culturel, le tourisme et la communication patrimoniale et culturelle.
Membres du jury
Prof. Philippe Marion (UCLouvain), Président du jury
Prof. Gérard Derèze (UCLouvain), Promoteur et Secrétaire du jury
Prof. Sébastien Fevry(UCLouvain), Lecteur
Dr. Fatoumata Toure Sylla (Université de Bamako), Lectrice extérieure
Dr. Rosalie Douyon (EDC Paris Business School), Lectrice extérieure -
 Aurore Courte - Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine08 Sep08 Sep...
Aurore Courte - Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine08 Sep08 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Aurore Courte
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine ».
Abstract
What is an individual? Can TV series help us answer this question? And how can they participate in the development of this notion? By comparing what six very different contemporary series tell us about individuality through its incarnation by their characters, a philosophical as well as a sociological discourse emerges.
Résumé
Qu’est-ce qu’un individu ? Les séries télévisées peuvent-elles nous aider à répondre à cette question ? Et en quoi peuvent-elles participer à l’élaboration de cette notion ? En comparant ce que nous disent six séries contemporaines très différentes sur l’individualité à travers son incarnation par leurs personnages, un discours philosophique autant que sociologique se fait jour.
Membres du jury
Professeur Lits Marc (UCLouvain), Promoteur
Professeur Sepulchre Sarah (UCLouvain), Promotrice et Secrétaire
Professeur Scieur Philippe (UCLouvain), Président
Professeur Dupuis Michel (UCLouvain)
Professeur Laugier Sandra (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Professeur Grandjean Nathalie (UNamur)En savoir plus Aurore Courte - Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine08 Sep08 Sep...
Aurore Courte - Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine08 Sep08 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Aurore Courte
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
« Les séries télévisées comme discours sur l’individualité contemporaine ».
Abstract
What is an individual? Can TV series help us answer this question? And how can they participate in the development of this notion? By comparing what six very different contemporary series tell us about individuality through its incarnation by their characters, a philosophical as well as a sociological discourse emerges.
Résumé
Qu’est-ce qu’un individu ? Les séries télévisées peuvent-elles nous aider à répondre à cette question ? Et en quoi peuvent-elles participer à l’élaboration de cette notion ? En comparant ce que nous disent six séries contemporaines très différentes sur l’individualité à travers son incarnation par leurs personnages, un discours philosophique autant que sociologique se fait jour.
Membres du jury
Professeur Lits Marc (UCLouvain), Promoteur
Professeur Sepulchre Sarah (UCLouvain), Promotrice et Secrétaire
Professeur Scieur Philippe (UCLouvain), Président
Professeur Dupuis Michel (UCLouvain)
Professeur Laugier Sandra (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Professeur Grandjean Nathalie (UNamur) -
 Gaël Gilson - Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire05 Jul05 Jul...
Gaël Gilson - Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire05 Jul05 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Gaël Gilson
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire
Lien Teams
Abstract
This research, at the crossroads of information and communication sciences, game studies and education sciences, aims at building a practice of video game education in a school context. Based on the principles of design research in education, it brings together theoretical development work with its practical implementation in secondary schools in French-speaking Belgium. Several objectives structure this work. The first category, which is rather theoretical, aims at defining video game education and the literacy that constitutes its framework. A second category, practical this time, envisages its implementation in the field. These objectives raise a variety of questions that are addressed in the thesis in an intertwined manner: What is video game education? What are the objectives of video game education? What place can video game literacy take in the contemporary media environment? How can video games be included in media education research? How can video game education be integrated into schools? What tools should be developed and made available to professionals to support the work of cultural mediation about video games? What activities should be organised?
This thesis presents answers to these questions through four segments. The first leads to the problematisation of video game education (differentiating it from education through video games), anchored in exploratory fieldwork. The second, while presenting the methodological device of the research, considers the place of video games in the field of media education. The third defines videogame literacy and builds a series of tools (for analysing video games in a school context and designing pedagogical scenarios around them) that allow it to be deployed in the field. The last one proposes a critical design of the practice of video game education, declined in activities that illustrate its pedagogical potential.
More generally, the construction of video game education and video game literacy in a school context meets the main objective of increasing young people's power of intervention in the media productions they explore. To this end, the second volume makes available to the public a collection of learning aids, documented and tested in the field.
Résumé
Cette recherche, à la croisée des sciences de l’information et de la communication, des game studies et des sciences de l’éducation, envisage la construction d’une pratique d’éducation aux jeux vidéo, en contexte scolaire. Conduite selon le devis de la recherche design en éducation, elle fait dialoguer un travail d’élaboration théorique avec sa mise en pratique dans des écoles secondaires, en Belgique francophone. Plusieurs objectifs éperonnent ce travail. Une première catégorie, plutôt théorique, vise à définir l’éducation aux jeux vidéo ainsi que la littératie qui en constitue le cadre de travail. Une seconde catégorie, pratique cette fois-ci, envisage sa mise en œuvre sur le terrain. Ces objectifs attisent une variété de questionnements abordés dans la thèse et ce, de manière entrelacée : qu’est-ce qu’éduquer aux jeux vidéo ? Quels sont les objectifs d’une éducation aux jeux vidéo ? Quelle place peut prendre la littératie vidéoludique dans l’environnement médiatique contemporain ? Comment inscrire les jeux vidéo dans la recherche en éducation aux médias ? Comment intégrer l’éducation aux jeux vidéo à l’école ? Quels outils construire et mettre à la disposition des professionnels et des professionnelles pour soutenir le travail de médiation culturelle autour des jeux vidéo ? Quelles activités organiser ?
L’ensemble du travail présente des réponses à ces questions à travers quatre segments. Le premier conduit à la problématisation de l’éducation aux jeux vidéo (en se démarquant de l’éducation par les jeux vidéo), ancrée dans un travail de terrain exploratoire. Le second, tout en présentant l’appareil méthodologique de la recherche, envisage la place du jeu vidéo dans le champ de l’éducation aux médias. Le troisième définit la littératie vidéoludique et construit une série d’outils (pour analyser des jeux vidéo en contexte scolaire et concevoir des scénarios pédagogiques autour de ces derniers) qui permettent de la déployer sur le terrain. Le dernier propose une mise en design critique de la pratique d’éducation aux jeux vidéo, déclinée en activités qui en illustrent le potentiel pédagogique.
Plus globalement, la construction d’une éducation aux jeux vidéo et d’une littératie vidéoludique en contexte scolaire répond à l’objectif principal de décupler le pouvoir d’intervention des jeunes dans les œuvres médiatiques qu’ils explorent. À cette fin, le second volume met à disposition du public un recueil de propositions pédagogiques, documentées et éprouvées sur le terrain.
Membres du jury
Professeur Vincent Berry (Université Paris 13)
Professeur Hugues Draelants (UCLouvain)
Professeur Sébastien Fevry (UCLouvain)
Professeur Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeur Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidentEn savoir plus Gaël Gilson - Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire05 Jul05 Jul...
Gaël Gilson - Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire05 Jul05 Jul...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Gaël Gilson
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en sciences de l’information et de la communication
Littératie vidéoludique. Éduquer aux jeux vidéo en contexte scolaire
Lien Teams
Abstract
This research, at the crossroads of information and communication sciences, game studies and education sciences, aims at building a practice of video game education in a school context. Based on the principles of design research in education, it brings together theoretical development work with its practical implementation in secondary schools in French-speaking Belgium. Several objectives structure this work. The first category, which is rather theoretical, aims at defining video game education and the literacy that constitutes its framework. A second category, practical this time, envisages its implementation in the field. These objectives raise a variety of questions that are addressed in the thesis in an intertwined manner: What is video game education? What are the objectives of video game education? What place can video game literacy take in the contemporary media environment? How can video games be included in media education research? How can video game education be integrated into schools? What tools should be developed and made available to professionals to support the work of cultural mediation about video games? What activities should be organised?
This thesis presents answers to these questions through four segments. The first leads to the problematisation of video game education (differentiating it from education through video games), anchored in exploratory fieldwork. The second, while presenting the methodological device of the research, considers the place of video games in the field of media education. The third defines videogame literacy and builds a series of tools (for analysing video games in a school context and designing pedagogical scenarios around them) that allow it to be deployed in the field. The last one proposes a critical design of the practice of video game education, declined in activities that illustrate its pedagogical potential.
More generally, the construction of video game education and video game literacy in a school context meets the main objective of increasing young people's power of intervention in the media productions they explore. To this end, the second volume makes available to the public a collection of learning aids, documented and tested in the field.
Résumé
Cette recherche, à la croisée des sciences de l’information et de la communication, des game studies et des sciences de l’éducation, envisage la construction d’une pratique d’éducation aux jeux vidéo, en contexte scolaire. Conduite selon le devis de la recherche design en éducation, elle fait dialoguer un travail d’élaboration théorique avec sa mise en pratique dans des écoles secondaires, en Belgique francophone. Plusieurs objectifs éperonnent ce travail. Une première catégorie, plutôt théorique, vise à définir l’éducation aux jeux vidéo ainsi que la littératie qui en constitue le cadre de travail. Une seconde catégorie, pratique cette fois-ci, envisage sa mise en œuvre sur le terrain. Ces objectifs attisent une variété de questionnements abordés dans la thèse et ce, de manière entrelacée : qu’est-ce qu’éduquer aux jeux vidéo ? Quels sont les objectifs d’une éducation aux jeux vidéo ? Quelle place peut prendre la littératie vidéoludique dans l’environnement médiatique contemporain ? Comment inscrire les jeux vidéo dans la recherche en éducation aux médias ? Comment intégrer l’éducation aux jeux vidéo à l’école ? Quels outils construire et mettre à la disposition des professionnels et des professionnelles pour soutenir le travail de médiation culturelle autour des jeux vidéo ? Quelles activités organiser ?
L’ensemble du travail présente des réponses à ces questions à travers quatre segments. Le premier conduit à la problématisation de l’éducation aux jeux vidéo (en se démarquant de l’éducation par les jeux vidéo), ancrée dans un travail de terrain exploratoire. Le second, tout en présentant l’appareil méthodologique de la recherche, envisage la place du jeu vidéo dans le champ de l’éducation aux médias. Le troisième définit la littératie vidéoludique et construit une série d’outils (pour analyser des jeux vidéo en contexte scolaire et concevoir des scénarios pédagogiques autour de ces derniers) qui permettent de la déployer sur le terrain. Le dernier propose une mise en design critique de la pratique d’éducation aux jeux vidéo, déclinée en activités qui en illustrent le potentiel pédagogique.
Plus globalement, la construction d’une éducation aux jeux vidéo et d’une littératie vidéoludique en contexte scolaire répond à l’objectif principal de décupler le pouvoir d’intervention des jeunes dans les œuvres médiatiques qu’ils explorent. À cette fin, le second volume met à disposition du public un recueil de propositions pédagogiques, documentées et éprouvées sur le terrain.
Membres du jury
Professeur Vincent Berry (Université Paris 13)
Professeur Hugues Draelants (UCLouvain)
Professeur Sébastien Fevry (UCLouvain)
Professeur Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeur Sarah Sepulchre (UCLouvain), président -
 Tama Rchika - Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières25 Jun25 Jun...
Tama Rchika - Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières25 Jun25 Jun...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Tama Rchika
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Sciences de l'Information et Communication
« Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières »
Lien Teams
Abstract
When an individual decides to launch an entrepreneurial project, he/she is regularly driven by a deep desire for autonomy. In this, the entrepreneur starts a journey where he/she tries to carry his/her ambitions alone. Furthermore, with the multiplication of spaces dedicated to entrepreneurship (incubators, accelerators, coworking spaces, fablabs, etc.) and with the exponential rise of digital technologies, the mobility of entrepreneurs continues to increase. They are constantly moving from one space to another, which further reinforces their isolation. However, by following several entrepreneurs in three distinct collectives, we quickly realized that they were caught in an ambivalence between a desire for independence and a strong need of others to face the challenges of their entrepreneurial journey. In other words, they seek to build their entrepreneurial practice through meetings, activities, arrangements, places and events. How then is their collaborative practice initiated and supported even if they are first and foremost focused on their own projects and objectives? How are their exchanges lasting even when they meet less and are more and more isolated? Through this doctoral thesis, we therefore propose to explore the challenges of building collaborative practices of entrepreneurs developing their project alone. We seek to understand how entrepreneurial collaboration emerges, develops and/or is maintained over time and space. To do this, we used an ethnographic methodology in three collectives seeking to bring together entrepreneurs, support their exchanges and more broadly, their collaboration: (1) Ouishare, (2) la Fabrique d'été and (3) Collaborative Innovation in Brussels. By relying on a three-way conceptual framework (the trials of Martuccelli; the boundary objects of Star and Griesemer; the communities of practice of Wenger) and by separately and transversally exploring these three case studies, we provided answers to our research question: What are the arrangements through which collaborative practice is built between entrepreneurs? More concretely, we have highlighted the need to open up the approach to entrepreneurial collaboration through the prism of practice and pointed out the main challenges of collaboration through a triptych that can be mobilized by the actors themselves: regularity of meetings, sources of energy and guideline giving meaning to the collaborative practices.
Résumé
Lorsqu’un individu décide de lancer un projet entrepreneurial, il est régulièrement animé d’une profonde volonté d’autonomie. En cela, l’entrepreneur.euse s’engage dans un cheminement où il tente de porter ses ambitions indépendamment de ses pairs. En outre, avec la démultiplication des espaces dédiés à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking, fablabs, etc.) et la montée exponentielle des technologies digitales, la mobilité des porteurs de projets ne cesse de s’accroitre. Ils transitent en permanence d’un espace à l’autre, ce qui renforce d’autant plus leur isolément. Or, en suivant plusieurs entrepreneurs en trois dispositifs distincts, nous sommes rapidement aperçue que ces derniers étaient pris dans une ambivalence entre un désir d’indépendance et un important besoin des autres pour faire face aux épreuves jalonnant le parcours entrepreneurial. En d’autres termes, ils cherchent à construire leur pratique entrepreneuriale au fil des rencontres, des activités, des arrangements, des lieux et des événements. Comment est dès lors initiée et soutenue leur pratique collaborative alors même qu’ils sont avant tout tournés vers leurs propres projets et objectifs ? Comment se tissent durablement leurs échanges alors même qu’ils se croisent moins et sont de plus en plus isolés ? A travers cette thèse de doctorat, nous nous proposons donc d’explorer les enjeux de la construction des pratiques collaboratives d’entrepreneurs portant seul leur projet. Nous cherchons ainsi à comprendre comment la collaboration entrepreneuriale émerge, se développe et/ou se maintient dans le temps et l’espace. Pour ce faire, nous avons mené un suivi ethnographique en trois dispositifs cherchant à rassembler des porteurs de projets hétérogènes pour stimuler et soutenir leurs échanges et plus largement, leur collaboration : (1) Ouishare, (2) la Fabrique d’été et (3) Innovation Collaborative à Bruxelles. En nous appuyant sur un cadre conceptuel à triple entrée (les épreuves de Martuccelli ; les objets-frontières de Star et Griesemer ; les communautés de pratique de Wenger) et en étudiant distinctement et transversalement ces trois cas d’étude, nous avons apporté des réponses à notre question de recherche, à savoir : Quels sont les arrangements à travers lesquels se construit la pratique collaborative entre porteurs de projets ? Plus concrètement, nous avons mis en lumière la nécessité de décloisonner l’approche de la collaboration entrepreneuriale par le prisme de la pratique et pointé les principaux enjeux de la collaboration à travers un triptyque mobilisable par les acteurs eux-mêmes, à savoir : la régularité des rencontres, les sources d’énergie soutenant les rencontres et la ligne directrice donnant sens aux rencontres et pratiques collaboratives.
Membres du jury
Professeur François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Professeur Damien Renard (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeur Ingrid Poncin (UCLouvain)
Professeur Julie Hermans (UCLouvain), président du jury
Professeur Viviane Sergi (UQAM)
Professeur Olivier Galibert (IUT Dijon)En savoir plus Tama Rchika - Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières25 Jun25 Jun...
Tama Rchika - Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières25 Jun25 Jun...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Tama Rchika
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Sciences de l'Information et Communication
« Suivre la pratique collaborative en entrepreneuriat - Une ethnographie de trois collectifs entrepreneuriaux par le prisme des objets-frontières »
Lien Teams
Abstract
When an individual decides to launch an entrepreneurial project, he/she is regularly driven by a deep desire for autonomy. In this, the entrepreneur starts a journey where he/she tries to carry his/her ambitions alone. Furthermore, with the multiplication of spaces dedicated to entrepreneurship (incubators, accelerators, coworking spaces, fablabs, etc.) and with the exponential rise of digital technologies, the mobility of entrepreneurs continues to increase. They are constantly moving from one space to another, which further reinforces their isolation. However, by following several entrepreneurs in three distinct collectives, we quickly realized that they were caught in an ambivalence between a desire for independence and a strong need of others to face the challenges of their entrepreneurial journey. In other words, they seek to build their entrepreneurial practice through meetings, activities, arrangements, places and events. How then is their collaborative practice initiated and supported even if they are first and foremost focused on their own projects and objectives? How are their exchanges lasting even when they meet less and are more and more isolated? Through this doctoral thesis, we therefore propose to explore the challenges of building collaborative practices of entrepreneurs developing their project alone. We seek to understand how entrepreneurial collaboration emerges, develops and/or is maintained over time and space. To do this, we used an ethnographic methodology in three collectives seeking to bring together entrepreneurs, support their exchanges and more broadly, their collaboration: (1) Ouishare, (2) la Fabrique d'été and (3) Collaborative Innovation in Brussels. By relying on a three-way conceptual framework (the trials of Martuccelli; the boundary objects of Star and Griesemer; the communities of practice of Wenger) and by separately and transversally exploring these three case studies, we provided answers to our research question: What are the arrangements through which collaborative practice is built between entrepreneurs? More concretely, we have highlighted the need to open up the approach to entrepreneurial collaboration through the prism of practice and pointed out the main challenges of collaboration through a triptych that can be mobilized by the actors themselves: regularity of meetings, sources of energy and guideline giving meaning to the collaborative practices.
Résumé
Lorsqu’un individu décide de lancer un projet entrepreneurial, il est régulièrement animé d’une profonde volonté d’autonomie. En cela, l’entrepreneur.euse s’engage dans un cheminement où il tente de porter ses ambitions indépendamment de ses pairs. En outre, avec la démultiplication des espaces dédiés à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking, fablabs, etc.) et la montée exponentielle des technologies digitales, la mobilité des porteurs de projets ne cesse de s’accroitre. Ils transitent en permanence d’un espace à l’autre, ce qui renforce d’autant plus leur isolément. Or, en suivant plusieurs entrepreneurs en trois dispositifs distincts, nous sommes rapidement aperçue que ces derniers étaient pris dans une ambivalence entre un désir d’indépendance et un important besoin des autres pour faire face aux épreuves jalonnant le parcours entrepreneurial. En d’autres termes, ils cherchent à construire leur pratique entrepreneuriale au fil des rencontres, des activités, des arrangements, des lieux et des événements. Comment est dès lors initiée et soutenue leur pratique collaborative alors même qu’ils sont avant tout tournés vers leurs propres projets et objectifs ? Comment se tissent durablement leurs échanges alors même qu’ils se croisent moins et sont de plus en plus isolés ? A travers cette thèse de doctorat, nous nous proposons donc d’explorer les enjeux de la construction des pratiques collaboratives d’entrepreneurs portant seul leur projet. Nous cherchons ainsi à comprendre comment la collaboration entrepreneuriale émerge, se développe et/ou se maintient dans le temps et l’espace. Pour ce faire, nous avons mené un suivi ethnographique en trois dispositifs cherchant à rassembler des porteurs de projets hétérogènes pour stimuler et soutenir leurs échanges et plus largement, leur collaboration : (1) Ouishare, (2) la Fabrique d’été et (3) Innovation Collaborative à Bruxelles. En nous appuyant sur un cadre conceptuel à triple entrée (les épreuves de Martuccelli ; les objets-frontières de Star et Griesemer ; les communautés de pratique de Wenger) et en étudiant distinctement et transversalement ces trois cas d’étude, nous avons apporté des réponses à notre question de recherche, à savoir : Quels sont les arrangements à travers lesquels se construit la pratique collaborative entre porteurs de projets ? Plus concrètement, nous avons mis en lumière la nécessité de décloisonner l’approche de la collaboration entrepreneuriale par le prisme de la pratique et pointé les principaux enjeux de la collaboration à travers un triptyque mobilisable par les acteurs eux-mêmes, à savoir : la régularité des rencontres, les sources d’énergie soutenant les rencontres et la ligne directrice donnant sens aux rencontres et pratiques collaboratives.
Membres du jury
Professeur François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Professeur Damien Renard (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeur Ingrid Poncin (UCLouvain)
Professeur Julie Hermans (UCLouvain), président du jury
Professeur Viviane Sergi (UQAM)
Professeur Olivier Galibert (IUT Dijon) -
 Tiffany Andry - Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ?05 Mar05 Mar...
Tiffany Andry - Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ?05 Mar05 Mar...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Tiffany Andry
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ? »
En distanciel pour le public via Microsoft Teams
Abstract
Today, the use of web 2.0 and social networks encourages the resurgence of data visualisation, which is often attractive and pleasing. Thanks to graphics, the information contained in data is impactful and communicated quickly. While the design principles of data visualization advocate simplicity and minimalism in graphical representations, there is a wealth of embellishment practices in the field. Several studies have demonstrated the added value of visual embellishment on memorization, recall and engagement, even though this practice encourages designers to disregard rules that are fundamental in this area. This doctoral dissertation aims to understand how data visualisations embellishment influences the users' sense making. In this research, sense making is seen as the interconnection between visual perception, understanding and personal experience. In order to understand it, the research focuses on forty experiments carried out by digital communication professionals. Between eye tracking and interviews, it describes the different factors that come into play when an individual makes sense of a graphic, while explaining the positive and negative influences of visual embellishments. All the results also led to a recommendation about the use of embellishment techniques, which can be directly used by data visualisation designers. By combining a multiplicity of data collection methods and data analysis methods, this research work leads to new perspectives in the field of information visualization and information and communication sciences.
Résumé
Actuellement, l’utilisation du web 2.0 et des réseaux socio-numériques encourage la recrudescence de la visualisation de données qui, bien souvent, est attrayante et agréable à regarder. Grâce aux graphiques, l’information contenue dans les données est communiquée rapidement et de façon percutante. Alors que les principes de conception des visualisations de données préconisent la simplicité et le minimalisme des représentations graphiques, de nombreuses pratiques d'ornementation foisonnent dans le domaine. Plusieurs études ont démontré les effets bénéfiques de l'ornementation sur la mémorisation et l'engagement, alors même que cette pratique encourage les designers à ne pas respecter des règles qui sont pourtant fondamentales en la matière. Cette thèse de doctorat vise à comprendre comment l'ornementation des visualisations de données influence la construction de sens des utilisateurs. Dans cette recherche, la construction de sens est considérée comme l'interconnexion entre la perception visuelle, la compréhension et l'expérience personnelle. Pour la comprendre, la recherche porte sur quarante expérimentations vécues par des professionnels de la communication numérique. Entre eye tracking et entretiens, elle décrit les différents facteurs qui entrent en compte lorsqu’un individu fait sens d’un graphique, tout en expliquant les influences positives et négatives de l’ornementation. L’ensemble des résultats a également mené à la formulation d’une recommandation en termes d’utilisation de techniques d’ornementation, directement utilisable par les concepteurs de visualisation de données. En combinant une multiplicité de méthodes de récolte de données et de méthodes d’analyse de données, ce travail de recherche mène vers de nouvelles perspectives dans le champ de la visualisation d’information et des sciences de l’information et de la communication.
Membres du jury
Professeur François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Professeur Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeure Suzanne Kieffer (UCLouvain), présidente du jury
Professeur Alexandru Telea (Université d’Utrecht)
Professeur Christophe Hurter (École Nationale de l’Aviation Civile, Toulouse)
Professeure Julia Bonaccorsi (Université Lumière Lyon 2 Berges du Rhône)En savoir plus Tiffany Andry - Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ?05 Mar05 Mar...
Tiffany Andry - Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ?05 Mar05 Mar...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Tiffany Andry
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Beauté des données. Quelle est l’influence de l’ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l’utilisateur ? »
En distanciel pour le public via Microsoft Teams
Abstract
Today, the use of web 2.0 and social networks encourages the resurgence of data visualisation, which is often attractive and pleasing. Thanks to graphics, the information contained in data is impactful and communicated quickly. While the design principles of data visualization advocate simplicity and minimalism in graphical representations, there is a wealth of embellishment practices in the field. Several studies have demonstrated the added value of visual embellishment on memorization, recall and engagement, even though this practice encourages designers to disregard rules that are fundamental in this area. This doctoral dissertation aims to understand how data visualisations embellishment influences the users' sense making. In this research, sense making is seen as the interconnection between visual perception, understanding and personal experience. In order to understand it, the research focuses on forty experiments carried out by digital communication professionals. Between eye tracking and interviews, it describes the different factors that come into play when an individual makes sense of a graphic, while explaining the positive and negative influences of visual embellishments. All the results also led to a recommendation about the use of embellishment techniques, which can be directly used by data visualisation designers. By combining a multiplicity of data collection methods and data analysis methods, this research work leads to new perspectives in the field of information visualization and information and communication sciences.
Résumé
Actuellement, l’utilisation du web 2.0 et des réseaux socio-numériques encourage la recrudescence de la visualisation de données qui, bien souvent, est attrayante et agréable à regarder. Grâce aux graphiques, l’information contenue dans les données est communiquée rapidement et de façon percutante. Alors que les principes de conception des visualisations de données préconisent la simplicité et le minimalisme des représentations graphiques, de nombreuses pratiques d'ornementation foisonnent dans le domaine. Plusieurs études ont démontré les effets bénéfiques de l'ornementation sur la mémorisation et l'engagement, alors même que cette pratique encourage les designers à ne pas respecter des règles qui sont pourtant fondamentales en la matière. Cette thèse de doctorat vise à comprendre comment l'ornementation des visualisations de données influence la construction de sens des utilisateurs. Dans cette recherche, la construction de sens est considérée comme l'interconnexion entre la perception visuelle, la compréhension et l'expérience personnelle. Pour la comprendre, la recherche porte sur quarante expérimentations vécues par des professionnels de la communication numérique. Entre eye tracking et entretiens, elle décrit les différents facteurs qui entrent en compte lorsqu’un individu fait sens d’un graphique, tout en expliquant les influences positives et négatives de l’ornementation. L’ensemble des résultats a également mené à la formulation d’une recommandation en termes d’utilisation de techniques d’ornementation, directement utilisable par les concepteurs de visualisation de données. En combinant une multiplicité de méthodes de récolte de données et de méthodes d’analyse de données, ce travail de recherche mène vers de nouvelles perspectives dans le champ de la visualisation d’information et des sciences de l’information et de la communication.
Membres du jury
Professeur François Lambotte (UCLouvain), promoteur
Professeur Pierre Fastrez (UCLouvain), promoteur et secrétaire
Professeure Suzanne Kieffer (UCLouvain), présidente du jury
Professeur Alexandru Telea (Université d’Utrecht)
Professeur Christophe Hurter (École Nationale de l’Aviation Civile, Toulouse)
Professeure Julia Bonaccorsi (Université Lumière Lyon 2 Berges du Rhône)
-
 Arnaud Claes - Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers21 Nov21 Nov...
Arnaud Claes - Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers21 Nov21 Nov...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Arnaud Claes
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers
Formulaire d’inscription et Lien Teams
Résumé
Un système de recommandation est un dispositif informatique de filtrage de l’information qui sélectionne de façon automatique des contenus médiatiques susceptibles d’intéresser l’utilisateur d’un service numérique. Ces technologies permettent de fournir une porte d’accès personnalisée à un catalogue d’objets trop volumineux pour être consulté manuellement. L’intégration croissante de ces systèmes au sein de l’écosystème numérique a suscité de nombreuses inquiétudes quant au maintien d’un espace public commun permettant aux individus d’être exposés à des informations qui divergent de leurs opinions et intérêts immédiats. Ce risque est accentué par les interfaces de ces dispositifs qui, afin de lisser l’expérience utilisateur, masquent le fonctionnement de l’algorithme et limitent l’implication de l’utilisateur dans le processus de recommandation. S’il est possible pour un utilisateur expérimenté d’appréhender le fonctionnement du système, il devient de plus en plus difficile pour la majorité des usagers d’évaluer l’effet de l’algorithme sur l’organisation de l’information. Un enjeu de recherche important consiste donc à explorer des trajectoires de design alternatives permettant aux utilisateurs d’appréhender par eux-mêmes les effets de ces technologies sur leurs pratiques médiatiques.
Dans le cadre de cette thèse, nous avons évalué l’effet de la contrôlabilité d’un système de recommandation sur l’autonomie individuelle de leurs utilisateurs. Pour ce faire, nous avons développé Alveho, une plateforme expérimentale alimentée quotidiennement en articles de presse issus de la RTBF. Pendant cinq semaines, les 23 participants de notre étude furent amenés à consulter quotidiennement ce site qui est équipé de son propre système de recommandation ainsi que d’outils permettant aux participants d’ajuster le comportement de l’algorithme. L’enregistrement des interactions de nos participants avec le système ainsi que la réalisation d’entretiens individuels nous permirent d’observer précisément leur comportement pendant la durée de l’étude.
Nos résultats nous indiquent que la présence d’outils de contrôle de l’algorithme n’est pas une condition suffisante pour permettre le développement de l’autonomie de l’utilisateur. Ce constat s’explique notamment par la surcharge cognitive importante que nécessite l’usage de ces composants additionnels. Nous avons également pu identifier plusieurs leviers prometteurs permettant de soutenir le développement d’une réflexion critique chez nos participants.
Membres du jury
Pr. Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire du jury
Pr. Pierre Fastrez (UCLouvain), président du jury
Pr. Jean-Samuel Beuscart (Télécom Paris), évaluateur externe
Pr. Maude Bonenfant (UQAM), comité d’accompagnement
Pr. Raphaël Jungers (UCLouvain), comité d’accompagnementEn savoir plus Arnaud Claes - Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers21 Nov21 Nov...
Arnaud Claes - Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers21 Nov21 Nov...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Arnaud Claes
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Algorithme de service public et autonomie critique : Etude des effets de la contrôlabilité d'un algorithme de recommandation sur l'autonomie critique de ses usagers
Formulaire d’inscription et Lien Teams
Résumé
Un système de recommandation est un dispositif informatique de filtrage de l’information qui sélectionne de façon automatique des contenus médiatiques susceptibles d’intéresser l’utilisateur d’un service numérique. Ces technologies permettent de fournir une porte d’accès personnalisée à un catalogue d’objets trop volumineux pour être consulté manuellement. L’intégration croissante de ces systèmes au sein de l’écosystème numérique a suscité de nombreuses inquiétudes quant au maintien d’un espace public commun permettant aux individus d’être exposés à des informations qui divergent de leurs opinions et intérêts immédiats. Ce risque est accentué par les interfaces de ces dispositifs qui, afin de lisser l’expérience utilisateur, masquent le fonctionnement de l’algorithme et limitent l’implication de l’utilisateur dans le processus de recommandation. S’il est possible pour un utilisateur expérimenté d’appréhender le fonctionnement du système, il devient de plus en plus difficile pour la majorité des usagers d’évaluer l’effet de l’algorithme sur l’organisation de l’information. Un enjeu de recherche important consiste donc à explorer des trajectoires de design alternatives permettant aux utilisateurs d’appréhender par eux-mêmes les effets de ces technologies sur leurs pratiques médiatiques.
Dans le cadre de cette thèse, nous avons évalué l’effet de la contrôlabilité d’un système de recommandation sur l’autonomie individuelle de leurs utilisateurs. Pour ce faire, nous avons développé Alveho, une plateforme expérimentale alimentée quotidiennement en articles de presse issus de la RTBF. Pendant cinq semaines, les 23 participants de notre étude furent amenés à consulter quotidiennement ce site qui est équipé de son propre système de recommandation ainsi que d’outils permettant aux participants d’ajuster le comportement de l’algorithme. L’enregistrement des interactions de nos participants avec le système ainsi que la réalisation d’entretiens individuels nous permirent d’observer précisément leur comportement pendant la durée de l’étude.
Nos résultats nous indiquent que la présence d’outils de contrôle de l’algorithme n’est pas une condition suffisante pour permettre le développement de l’autonomie de l’utilisateur. Ce constat s’explique notamment par la surcharge cognitive importante que nécessite l’usage de ces composants additionnels. Nous avons également pu identifier plusieurs leviers prometteurs permettant de soutenir le développement d’une réflexion critique chez nos participants.
Membres du jury
Pr. Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire du jury
Pr. Pierre Fastrez (UCLouvain), président du jury
Pr. Jean-Samuel Beuscart (Télécom Paris), évaluateur externe
Pr. Maude Bonenfant (UQAM), comité d’accompagnement
Pr. Raphaël Jungers (UCLouvain), comité d’accompagnement -
 Marie Van Cranenbroeck - Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics24 Oct24 Oct...
Marie Van Cranenbroeck - Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics24 Oct24 Oct...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Marie Van Cranenbroeck
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
“Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics”
Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale a été menée sur un temps long (2010-2022), elle se situe entre le monde des musées et les sciences de l’information et la communication. Le départ de cette thèse (octobre 2010) correspond à une période où les musées ont commencé à s’inscrire en plus grand nombre sur Facebook et Twitter. Au même moment, les sciences de l’information et de la communication revisitaient les concepts de publics, de communautés ou de participation, au regard d’Internet et des médias sociaux en ligne.
Les enquêtes sur les pratiques muséales montrent que l’accès aux musées est fortement lié à des critères socioéconomiques, particulièrement le niveau d’éducation des visiteurs. Les musées ont tenté et tentent encore de diminuer ces inégalités d’accès grâce à différents outils de médiation, parmi lesquels figurent aujourd’hui leurs comptes Facebook et Twitter. Ces dispositifs en ligne renouvellent-ils les relations entre musées et publics, permettent-ils de dépasser cette relation d’accès, retrouve-t-on plus de traces d’interaction, voire de participation ?
Pour répondre à cette question qui est le fil rouge de cette thèse, nous avons choisi de nous concentrer sur les usages de Facebook et Twitter par des musées moins étudiés que les musées dits superstars tels que le Louvre ou le British Museum. Les quatre musées qui constituent le terrain de cette recherche se situent en Belgique (Musée royal de Mariemont et Museum aan de Stroom) et au Grand-Duché de Luxembourg (Musée national d’histoire et d’art et Mudam).
Dans un premier temps, une analyse de contenu a été effectuée sur des données extraites des comptes Facebook et Twitter des quatre musées, ce qui correspond à une année d’usages (2011-2012). Cette analyse a été utile à deux niveaux. Le premier se situe à un niveau méthodologique. Malgré le nombre peu important de données (1998 tweets, 328 billets et 679 commentaires Facebook), celles-ci partagent des enjeux liés aux Big Data, particulièrement les questions éthiques d’extraction des données et les choix de délimitation du corpus d’analyse qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les résultats. Le deuxième niveau se retrouve dans l’expérimentation du classement des données extraites selon le modèle AIP (Accès-Interaction-Participation) tel que développé par Nico Carpentier (2011) et basé sur les travaux de Carole Pateman (1970). Cette expérimentation a permis de dégager la part d’accès toujours bien présente parmi les usages de Facebook et Twitter et d’interroger les concepts d’interaction et de participation, souvent convoqués et confondus dans le contexte des réseaux sociaux en ligne.
Dans un second temps, pour compléter cette analyse de contenu qui parle des usagers (musées et publics), qui s’emparent déjà des réseaux sociaux en ligne, en 2013, un questionnaire a été distribué dans les quatre musées du corpus et en ligne (908 questionnaires), afin d’obtenir des éléments quantitatifs sur les usages (ou non) des dispositifs en ligne investis par les musées. Afin de mieux comprendre le contexte des (non-)usages de Facebook et Twitter, des entretiens ont été menés avec des personnes qui ont répondu au questionnaire (22 entretiens) et avec des professionnels qui travaillaient dans les quatre musées du corpus (17 entretiens).
Cette recherche se conclut au moment où l’International Council of Museums (ICOM) s’est choisi une nouvelle définition du musée (août 2022). Celle-ci fait appel à des concepts et des réalités qui ont été mis à l’épreuve au cours de cette thèse (publics, accès, éthique, participation, communautés ou partage de connaissances). Cette nouvelle définition rappelle que le dialogue entre musées et sciences de l’information et de la communication enrichit le travail de terrain et de recherche des uns et des autres.
Abstract
This doctoral research was completed over a long period of time (2010-2022) and is positioned between the world of museums and the information and communication sciences. The start of this research (October 2010) corresponds to a period when museums began to register in larger numbers on Facebook and Twitter. At the same time, the information and communication sciences were revisiting the concepts of audiences, communities or participation, in light of the Internet and social network sites.
Surveys on museum practices show that access to museums is strongly linked to socio-economic criteria, particularly the education level of visitors. Museums have tried and are still trying to reduce these inequalities of access thanks to various mediation tools, including their Facebook and Twitter accounts. Do these social network sites renew the relationship between museums and audiences, do they make it possible to go beyond this relationship of access, do we find more traces of interaction, or even participation?
To answer this question, which is the main theme of this doctoral research, we chose to focus on the uses of Facebook and Twitter by museums that are less studied than the so-called superstar museums such as the Louvre or the British Museum. The four museums that provide the basis for this research are located in Belgium (Musée royal de Mariemont and Museum aan de Stroom) and in the Grand Duchy of Luxembourg (Musée national d’histoire et d’art and Mudam).
First, a content analysis was carried out on data extracted from the Facebook and Twitter accounts of the four museums, which covers one year of uses (2011-2012). This analysis was useful on two levels. The first is methodological. Despite the small amount of data (1998 tweets, 328 posts and 679 Facebook comments), it corresponds with issues related to Big Data, particularly the ethical questions of data extraction and the choices made in delimiting the corpus of the analysis, which can have important consequences on the results. The second level is found in the experimentation of the classification of the extracted data according to the AIP model (Access-Interaction-Participation) developed by Nico Carpentier (2011) and based on the work of Carole Pateman (1970). This experimentation allowed us to identify the part of access that is still present among the uses of Facebook and Twitter and to question the concepts of interaction and participation, which are often brought together and confused in the context of social network sites.
Secondly, in order to complete this content analysis on users (museums and audiences), who are already using social network sites, in 2013 a survey was distributed in the four museums and online (908 questionnaires), in order to obtain quantitative data on the uses (or non-uses) of the various online platforms adopted by the museums. For a better understanding of the context of the (non-)uses of Facebook and Twitter, interviews were conducted with people who completed the survey (22 interviews) and with professionals who worked in the four museums (17 interviews).
This research concluded just as the International Council of Museums (ICOM) has chosen a new definition of museum (August 2022). This definition points to concepts and realities that have been challenged during this doctoral research (audiences, access, ethics, participation, communities or knowledge sharing). This new definition reminds us that the dialogue between museums and the information and communication sciences mutually enriches fieldwork and research.
Membres du jury
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), promotrice
Prof. Sandrine Roginsky (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Gaëlle Crenn (Université de Lorraine), évaluatrice externe
Prof. Geoffroy Patriarche (Université Saint-Louis – Bruxelles), évaluateur externe
Prof. Ralph Dekoninck (UCLouvain), comité d’accompagnementEn savoir plus Marie Van Cranenbroeck - Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics24 Oct24 Oct...
Marie Van Cranenbroeck - Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics24 Oct24 Oct...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Marie Van Cranenbroeck
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
“Musées et publics, usagers des réseaux sociaux en ligne. Une étude des usages de Facebook et Twitter par quatre musées belges et luxembourgeois et les publics”
Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale a été menée sur un temps long (2010-2022), elle se situe entre le monde des musées et les sciences de l’information et la communication. Le départ de cette thèse (octobre 2010) correspond à une période où les musées ont commencé à s’inscrire en plus grand nombre sur Facebook et Twitter. Au même moment, les sciences de l’information et de la communication revisitaient les concepts de publics, de communautés ou de participation, au regard d’Internet et des médias sociaux en ligne.
Les enquêtes sur les pratiques muséales montrent que l’accès aux musées est fortement lié à des critères socioéconomiques, particulièrement le niveau d’éducation des visiteurs. Les musées ont tenté et tentent encore de diminuer ces inégalités d’accès grâce à différents outils de médiation, parmi lesquels figurent aujourd’hui leurs comptes Facebook et Twitter. Ces dispositifs en ligne renouvellent-ils les relations entre musées et publics, permettent-ils de dépasser cette relation d’accès, retrouve-t-on plus de traces d’interaction, voire de participation ?
Pour répondre à cette question qui est le fil rouge de cette thèse, nous avons choisi de nous concentrer sur les usages de Facebook et Twitter par des musées moins étudiés que les musées dits superstars tels que le Louvre ou le British Museum. Les quatre musées qui constituent le terrain de cette recherche se situent en Belgique (Musée royal de Mariemont et Museum aan de Stroom) et au Grand-Duché de Luxembourg (Musée national d’histoire et d’art et Mudam).
Dans un premier temps, une analyse de contenu a été effectuée sur des données extraites des comptes Facebook et Twitter des quatre musées, ce qui correspond à une année d’usages (2011-2012). Cette analyse a été utile à deux niveaux. Le premier se situe à un niveau méthodologique. Malgré le nombre peu important de données (1998 tweets, 328 billets et 679 commentaires Facebook), celles-ci partagent des enjeux liés aux Big Data, particulièrement les questions éthiques d’extraction des données et les choix de délimitation du corpus d’analyse qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les résultats. Le deuxième niveau se retrouve dans l’expérimentation du classement des données extraites selon le modèle AIP (Accès-Interaction-Participation) tel que développé par Nico Carpentier (2011) et basé sur les travaux de Carole Pateman (1970). Cette expérimentation a permis de dégager la part d’accès toujours bien présente parmi les usages de Facebook et Twitter et d’interroger les concepts d’interaction et de participation, souvent convoqués et confondus dans le contexte des réseaux sociaux en ligne.
Dans un second temps, pour compléter cette analyse de contenu qui parle des usagers (musées et publics), qui s’emparent déjà des réseaux sociaux en ligne, en 2013, un questionnaire a été distribué dans les quatre musées du corpus et en ligne (908 questionnaires), afin d’obtenir des éléments quantitatifs sur les usages (ou non) des dispositifs en ligne investis par les musées. Afin de mieux comprendre le contexte des (non-)usages de Facebook et Twitter, des entretiens ont été menés avec des personnes qui ont répondu au questionnaire (22 entretiens) et avec des professionnels qui travaillaient dans les quatre musées du corpus (17 entretiens).
Cette recherche se conclut au moment où l’International Council of Museums (ICOM) s’est choisi une nouvelle définition du musée (août 2022). Celle-ci fait appel à des concepts et des réalités qui ont été mis à l’épreuve au cours de cette thèse (publics, accès, éthique, participation, communautés ou partage de connaissances). Cette nouvelle définition rappelle que le dialogue entre musées et sciences de l’information et de la communication enrichit le travail de terrain et de recherche des uns et des autres.
Abstract
This doctoral research was completed over a long period of time (2010-2022) and is positioned between the world of museums and the information and communication sciences. The start of this research (October 2010) corresponds to a period when museums began to register in larger numbers on Facebook and Twitter. At the same time, the information and communication sciences were revisiting the concepts of audiences, communities or participation, in light of the Internet and social network sites.
Surveys on museum practices show that access to museums is strongly linked to socio-economic criteria, particularly the education level of visitors. Museums have tried and are still trying to reduce these inequalities of access thanks to various mediation tools, including their Facebook and Twitter accounts. Do these social network sites renew the relationship between museums and audiences, do they make it possible to go beyond this relationship of access, do we find more traces of interaction, or even participation?
To answer this question, which is the main theme of this doctoral research, we chose to focus on the uses of Facebook and Twitter by museums that are less studied than the so-called superstar museums such as the Louvre or the British Museum. The four museums that provide the basis for this research are located in Belgium (Musée royal de Mariemont and Museum aan de Stroom) and in the Grand Duchy of Luxembourg (Musée national d’histoire et d’art and Mudam).
First, a content analysis was carried out on data extracted from the Facebook and Twitter accounts of the four museums, which covers one year of uses (2011-2012). This analysis was useful on two levels. The first is methodological. Despite the small amount of data (1998 tweets, 328 posts and 679 Facebook comments), it corresponds with issues related to Big Data, particularly the ethical questions of data extraction and the choices made in delimiting the corpus of the analysis, which can have important consequences on the results. The second level is found in the experimentation of the classification of the extracted data according to the AIP model (Access-Interaction-Participation) developed by Nico Carpentier (2011) and based on the work of Carole Pateman (1970). This experimentation allowed us to identify the part of access that is still present among the uses of Facebook and Twitter and to question the concepts of interaction and participation, which are often brought together and confused in the context of social network sites.
Secondly, in order to complete this content analysis on users (museums and audiences), who are already using social network sites, in 2013 a survey was distributed in the four museums and online (908 questionnaires), in order to obtain quantitative data on the uses (or non-uses) of the various online platforms adopted by the museums. For a better understanding of the context of the (non-)uses of Facebook and Twitter, interviews were conducted with people who completed the survey (22 interviews) and with professionals who worked in the four museums (17 interviews).
This research concluded just as the International Council of Museums (ICOM) has chosen a new definition of museum (August 2022). This definition points to concepts and realities that have been challenged during this doctoral research (audiences, access, ethics, participation, communities or knowledge sharing). This new definition reminds us that the dialogue between museums and the information and communication sciences mutually enriches fieldwork and research.
Membres du jury
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), promotrice
Prof. Sandrine Roginsky (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Gaëlle Crenn (Université de Lorraine), évaluatrice externe
Prof. Geoffroy Patriarche (Université Saint-Louis – Bruxelles), évaluateur externe
Prof. Ralph Dekoninck (UCLouvain), comité d’accompagnement -
 Lara Burton - S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé19 Sep19 Sep...
Lara Burton - S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé19 Sep19 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Lara Burton
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteure en information et communication
“S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé”
Lien Teams
Résumé
L’intégration successive des jeunes générations au corps politique est importante, car elle permet le bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques et le développement d’un sentiment d’appartenance des individus envers la communauté plus étendue. Cependant, ces dernières décennies, divers travaux scientifiques s’inquiètent du désengagement politique des jeunes, et s’intéressent au développement de nouvelles formes d’engagement, non-institutionnalisées ou médiatiques. En sciences de l’information et de la communication, et spécifiquement dans le champ de la littératie médiatique, des études postulent que l’éducation aux médias pourrait favoriser une citoyenneté active des jeunes. Ces études cherchent notamment à comprendre l’influence des activités éducatives, et des compétences médiatiques qu’elles développent, sur la participation civique (effective ou potentielle) des adolescent·e·s et des jeunes adultes. Dans la lignée de ces recherches, nous nous interrogeons : Quel est le lien entre la littératie médiatique et l’engagement civique ? De façon distinctive, nous choisissons de nous intéresser à des situations concrètes d’engagement civique et cherchons à comprendre le rôle que les médias y jouent.
Notre thèse de doctorat porte sur le lien entre l’engagement civique de jeunes adultes (25-30 ans) au sein d’un groupe auto-organisé et leur littératie médiatique (envisagée sous l’angle des pratiques). Nous mobilisons une méthode qualitative et compréhensive, mêlant principalement des observations et des entretiens, afin d’étudier deux groupes civiques situés en Belgique francophone, dans le Brabant wallon (premier terrain) et en Région de Bruxelles-Capitale (second terrain). Le travail empirique réalisé au sein du premier terrain nous conduit à décrire les pratiques médiatiques de jeunes adultes engagé·e·s, et à mieux appréhender le paysage civique belge francophone. Le second terrain nous permet de comprendre la façon dont ces pratiques médiatiques s’insèrent dans des pratiques sociales plus vastes, et de découvrir comment les jeunes adultes étudié·e·s s’intègrent au collectif civique, comment iels y investissent du temps et de l’énergie, comment iels y participent en tant qu’individu, et comment iels agissent ensemble pour construire une société avec laquelle iels sont en accord.
Dans une perspective théorique et méthodologique, nous identifions les axes de tension qui sous-tendent l’étude de la littératie, nous discutions du flou conceptuel qui entoure les notions d’engagement et de participation, et nous offrons un panorama des méthodes mobilisées pour étudier le lien entre médias et engagement civique. Dans une perspective empirique, nous soulignons l’influence croisée de l’individu et du groupe social dans le développement de pratiques (par exemple, la nature systémique des pratiques informationnelles, où les individus s’informent eux-mêmes, informent les autres et sont informés par eux). En conclusion, l’engagement civique au sein d’un groupe auto-organisé, orienté vers l’action, et valorisant la bienveillance, le dialogue et l’écoute, apparaît comme un contexte propice au développement de la littératie médiatique et, plus largement, d’une réflexivité relative aux pratiques sociales. En ce sens, nous formulons des recommandations, notamment à destination des initiatives d’éducation aux médias et à la citoyenneté, afin d’encourager les expériences civiques en contexte scolaire et dans l’éducation permanente. Nous mettons également en lumière des pistes de réflexion à destination des groupes civiques.
Abstract
The successive integration of the younger generations into the political body is important for the proper functioning of our democratic societies and the development of individuals’ sense of belonging to the wider community. However, in the last decades, various studies have raised concerns about the political disengagement of young people and have investigated the development of new, non-institutionalised or media-based forms of engagement. In the information and communication sciences, and specifically in the field of media literacy, studies postulate that media education could support active citizenship among young people. In particular, these studies seek to understand the influence of educational activities, and the media competences they develop, on the (actual or potential) civic participation of adolescents and young adults. In line with these studies, we wonder: What is the link between media literacy and civic engagement? In a distinctive way, we choose to focus on actual situations of civic engagement and seek to understand what role the media play in them.
Our PhD thesis examines the link between young adults’ (25-30 years old) civic engagement within a self-organised group and their media literacy (considered from the perspective of practices). We mobilise a qualitative and comprehensive method, which combines mainly observations and interviews, to study two civic groups located in French-speaking Belgium, namely in Walloon Brabant (first fieldwork) and in Brussels Region (second fieldwork). The empirical work carried out in the first fieldwork enables us to describe the media practices of civically engaged young adults and to develop a better understanding of the Belgian French-speaking civic landscape. The second fieldwork enables us to understand the way these media practices are embedded in broader social practices, and to discover how the young adults studied integrate themselves into the civic group, invest time and energy in it, participate as individuals, and act together to build a society they resonate with.
From a theoretical and methodological perspective, we identify axes of tension that underlie the study of literacy, we discuss the conceptual vagueness of the notions of engagement and participation, and we offer an overview of the methods used to study the link between media and civic engagement. From an empirical perspective, we emphasise the interplay between the individual and the social group in the development of practices (e.g. the systemic nature of informational practices, whereby individuals inform themselves, inform others and are informed by them). In conclusion, civic engagement within a self-organised, action-oriented group, which values kindness, dialogue and listening, appears to be a favourable context for the development of media literacy and, more broadly, of a reflexivity related to social practices. In this sense, we formulate recommendations, notably for media and citizenship education initiatives, in order to encourage civic experiences in the school context and in lifelong learning. We also highlight areas of reflections for civic groups.
Membres du jury
Pierre Fastrez (promoteur et secrétaire), Université catholique de Louvain
Mathieu Berger (président), Université catholique de Louvain
Anne-Sophie Collard, Université de Namur
Christophe Lejeune, Université de Liège
Stéphanie Wojcik, Université Paris Est CréteilEn savoir plus Lara Burton - S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé19 Sep19 Sep...
Lara Burton - S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé19 Sep19 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Lara Burton
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteure en information et communication
“S’intégrer, s’investir, participer et agir. Étude des pratiques médiatiques mobilisées par de jeunes adultes engagés dans un groupe civique auto-organisé”
Lien Teams
Résumé
L’intégration successive des jeunes générations au corps politique est importante, car elle permet le bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques et le développement d’un sentiment d’appartenance des individus envers la communauté plus étendue. Cependant, ces dernières décennies, divers travaux scientifiques s’inquiètent du désengagement politique des jeunes, et s’intéressent au développement de nouvelles formes d’engagement, non-institutionnalisées ou médiatiques. En sciences de l’information et de la communication, et spécifiquement dans le champ de la littératie médiatique, des études postulent que l’éducation aux médias pourrait favoriser une citoyenneté active des jeunes. Ces études cherchent notamment à comprendre l’influence des activités éducatives, et des compétences médiatiques qu’elles développent, sur la participation civique (effective ou potentielle) des adolescent·e·s et des jeunes adultes. Dans la lignée de ces recherches, nous nous interrogeons : Quel est le lien entre la littératie médiatique et l’engagement civique ? De façon distinctive, nous choisissons de nous intéresser à des situations concrètes d’engagement civique et cherchons à comprendre le rôle que les médias y jouent.
Notre thèse de doctorat porte sur le lien entre l’engagement civique de jeunes adultes (25-30 ans) au sein d’un groupe auto-organisé et leur littératie médiatique (envisagée sous l’angle des pratiques). Nous mobilisons une méthode qualitative et compréhensive, mêlant principalement des observations et des entretiens, afin d’étudier deux groupes civiques situés en Belgique francophone, dans le Brabant wallon (premier terrain) et en Région de Bruxelles-Capitale (second terrain). Le travail empirique réalisé au sein du premier terrain nous conduit à décrire les pratiques médiatiques de jeunes adultes engagé·e·s, et à mieux appréhender le paysage civique belge francophone. Le second terrain nous permet de comprendre la façon dont ces pratiques médiatiques s’insèrent dans des pratiques sociales plus vastes, et de découvrir comment les jeunes adultes étudié·e·s s’intègrent au collectif civique, comment iels y investissent du temps et de l’énergie, comment iels y participent en tant qu’individu, et comment iels agissent ensemble pour construire une société avec laquelle iels sont en accord.
Dans une perspective théorique et méthodologique, nous identifions les axes de tension qui sous-tendent l’étude de la littératie, nous discutions du flou conceptuel qui entoure les notions d’engagement et de participation, et nous offrons un panorama des méthodes mobilisées pour étudier le lien entre médias et engagement civique. Dans une perspective empirique, nous soulignons l’influence croisée de l’individu et du groupe social dans le développement de pratiques (par exemple, la nature systémique des pratiques informationnelles, où les individus s’informent eux-mêmes, informent les autres et sont informés par eux). En conclusion, l’engagement civique au sein d’un groupe auto-organisé, orienté vers l’action, et valorisant la bienveillance, le dialogue et l’écoute, apparaît comme un contexte propice au développement de la littératie médiatique et, plus largement, d’une réflexivité relative aux pratiques sociales. En ce sens, nous formulons des recommandations, notamment à destination des initiatives d’éducation aux médias et à la citoyenneté, afin d’encourager les expériences civiques en contexte scolaire et dans l’éducation permanente. Nous mettons également en lumière des pistes de réflexion à destination des groupes civiques.
Abstract
The successive integration of the younger generations into the political body is important for the proper functioning of our democratic societies and the development of individuals’ sense of belonging to the wider community. However, in the last decades, various studies have raised concerns about the political disengagement of young people and have investigated the development of new, non-institutionalised or media-based forms of engagement. In the information and communication sciences, and specifically in the field of media literacy, studies postulate that media education could support active citizenship among young people. In particular, these studies seek to understand the influence of educational activities, and the media competences they develop, on the (actual or potential) civic participation of adolescents and young adults. In line with these studies, we wonder: What is the link between media literacy and civic engagement? In a distinctive way, we choose to focus on actual situations of civic engagement and seek to understand what role the media play in them.
Our PhD thesis examines the link between young adults’ (25-30 years old) civic engagement within a self-organised group and their media literacy (considered from the perspective of practices). We mobilise a qualitative and comprehensive method, which combines mainly observations and interviews, to study two civic groups located in French-speaking Belgium, namely in Walloon Brabant (first fieldwork) and in Brussels Region (second fieldwork). The empirical work carried out in the first fieldwork enables us to describe the media practices of civically engaged young adults and to develop a better understanding of the Belgian French-speaking civic landscape. The second fieldwork enables us to understand the way these media practices are embedded in broader social practices, and to discover how the young adults studied integrate themselves into the civic group, invest time and energy in it, participate as individuals, and act together to build a society they resonate with.
From a theoretical and methodological perspective, we identify axes of tension that underlie the study of literacy, we discuss the conceptual vagueness of the notions of engagement and participation, and we offer an overview of the methods used to study the link between media and civic engagement. From an empirical perspective, we emphasise the interplay between the individual and the social group in the development of practices (e.g. the systemic nature of informational practices, whereby individuals inform themselves, inform others and are informed by them). In conclusion, civic engagement within a self-organised, action-oriented group, which values kindness, dialogue and listening, appears to be a favourable context for the development of media literacy and, more broadly, of a reflexivity related to social practices. In this sense, we formulate recommendations, notably for media and citizenship education initiatives, in order to encourage civic experiences in the school context and in lifelong learning. We also highlight areas of reflections for civic groups.
Membres du jury
Pierre Fastrez (promoteur et secrétaire), Université catholique de Louvain
Mathieu Berger (président), Université catholique de Louvain
Anne-Sophie Collard, Université de Namur
Christophe Lejeune, Université de Liège
Stéphanie Wojcik, Université Paris Est Créteil -
 Christelle Sukadi - Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)15 Sep15 Sep...
Christelle Sukadi - Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)15 Sep15 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Madame Christelle Sukadi
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)
Lien Teams
Résumé
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TICs) se sont imposées au fil des ans dans les discours stratégiques des organisations, comme une solution de bonne gouvernance et un levier crucial de modernisation. Dans le contexte des universités d’Afrique subsaharienne, la réalité est parfois bien loin de ces discours prometteurs, et ce, malgré les multiples initiatives technologiques développées. C’est cette situation paradoxale que nous avons constatée et analysée dans une université en modernisation. Cette dernière a développé depuis plus de quinze ans, un logiciel de gestion académique qui demeure sous-exploité malgré son fort potentiel. A travers une analyse des discours provenant d’un corpus hétérogène, cette thèse contribue non seulement à la compréhension des résistances dans l’implémentation des TICs ; mais elle vise également à développer une analyse critique des politiques de modernisation des universités africaines par le biais les TICs.
Membres du jury
Sandrine Roginsky, UCLouvain, présidente
François Lambotte, UCLouvain, co-promoteur et secrétaire
Jacky Mpungu Mulenda Saidi, Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo, co-promoteur
Claire Oger, Université Paris-Est Créteil, France
Jan Zienkowski, Université libre de Bruxelles, BelgiqueEn savoir plus Christelle Sukadi - Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)15 Sep15 Sep...
Christelle Sukadi - Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)15 Sep15 Sep...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Madame Christelle Sukadi
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en information et communication
Gouvernance universitaire : Problématique et enjeux de l’implémentation d’un logiciel de gestion académique en contexte de modernisation - Le cas du logiciel GP7 à l’Université de Lubumbashi (RDC)
Lien Teams
Résumé
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TICs) se sont imposées au fil des ans dans les discours stratégiques des organisations, comme une solution de bonne gouvernance et un levier crucial de modernisation. Dans le contexte des universités d’Afrique subsaharienne, la réalité est parfois bien loin de ces discours prometteurs, et ce, malgré les multiples initiatives technologiques développées. C’est cette situation paradoxale que nous avons constatée et analysée dans une université en modernisation. Cette dernière a développé depuis plus de quinze ans, un logiciel de gestion académique qui demeure sous-exploité malgré son fort potentiel. A travers une analyse des discours provenant d’un corpus hétérogène, cette thèse contribue non seulement à la compréhension des résistances dans l’implémentation des TICs ; mais elle vise également à développer une analyse critique des politiques de modernisation des universités africaines par le biais les TICs.
Membres du jury
Sandrine Roginsky, UCLouvain, présidente
François Lambotte, UCLouvain, co-promoteur et secrétaire
Jacky Mpungu Mulenda Saidi, Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo, co-promoteur
Claire Oger, Université Paris-Est Créteil, France
Jan Zienkowski, Université libre de Bruxelles, Belgique -
Charlotte Préat - Les pratiques ludiques des enseignants et enseignantes du primaire – Une étude de cas en Fédération Wallonie-Bruxelles pour éclairer l'intégration d'une dimension ludique aux pratiques d'enseignement20 Jun20 Jun...
Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Charlotte Préat
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteure en information et communication
Les pratiques ludiques des enseignants et enseignantes du primaire – Une étude de cas en Fédération Wallonie-Bruxelles pour éclairer l'intégration d'une dimension ludique aux pratiques d'enseignement
Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale, inscrite en sciences de l'information et de la communication, porte sur les pratiques ludiques professionnelles des instituteurs et institutrices primaires qui exercent dans l'enseignement ordinaire (i.e. non spécialisé) sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes années et tous réseaux d'enseignement confondus. Ce sont les pratiques ludiques actuelles qui ont été étudiées dans le cadre de cette recherche : tant les supports analogiques, numériques et hybrides mobilisés par les instituteurs y ont été considérés. Elle poursuit un double objectif : décrire les pratiques ludiques des instituteurs et comprendre ces pratiques. Une méthode découpée en plusieurs phases, inductive et mixte, a ainsi été mise en œuvre. Cette recherche doctorale est toutefois principalement qualitative, les différentes démarches étant au service d'une étude de cas. Lors de cette dernière, neuf enseignants et enseignantes ayant des pratiques ludiques diversifiées ont été suivis, ce durant une année scolaire.
À partir des données recueillies, trois regards ont été croisés sur les pratiques des instituteurs ayant constitué les "cas" : celui que la chercheuse a posé sur leurs pratiques, le leur sur leurs propres pratiques et celui de leurs élèves, à partir de leur vécu en classe. Ces données ont été analysées suivant trois axes, qui structurent le manuscrit : a) "le jeu sur notre terrain", qui vise à répondre aux questions "sur quels éléments la dimension ludique des pratiques d'enseignement repose-elle ?" et "comment cette dimension ludique est-elle perçue par les élèves ?" ; b) "l'introduction du jeu dans les pratiques d'enseignement", centré sur la question "via quelles actions concrètes les instituteurs donnent-ils une dimension ludique à leurs contenus d'enseignement lorsqu'ils les planifient et les mettent en forme ?" ; et c) "l'expérience du jeu en classe", qui vise à répondre aux questions "comment le jeu est-il proposé aux élèves en classe ?" et "quelles relations le jeu induit-il entre les élèves et entre l'enseignant et les élèves ?".
Afin de proposer des pistes de réponse aux besoins exprimés par les participants et participantes à l'étude de cas, ainsi qu'aux freins liés à l'intégration du jeu aux pratiques d'enseignement identifiés sur le terrain, une dernière collecte de données été menée auprès d'acteurs et actrices dits "contextuels". Ces termes désignent des acteurs belges francophones qui travaillent pour et/ou avec des enseignants dont les pratiques professionnelles ont une dimension ludique. Cette démarche, menée dans une perspective d'ouverture, a mis en évidence que, si les instituteurs en sont peu (ou pas) conscients, ils peuvent solliciter une série de personnes-ressources qui gravitent autour d'eux, dans le paysage belge francophone.
Membres du jury
Prof. Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire du jury
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Vinciane Zabban (Université Paris 13), évaluatrice externe
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Benoît Galand (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Cédric Heuchenne (UCLouvain), comité d’accompagnementEn savoir plusCharlotte Préat - Les pratiques ludiques des enseignants et enseignantes du primaire – Une étude de cas en Fédération Wallonie-Bruxelles pour éclairer l'intégration d'une dimension ludique aux pratiques d'enseignement20 Jun20 Jun...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Charlotte Préat
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteure en information et communication
Les pratiques ludiques des enseignants et enseignantes du primaire – Une étude de cas en Fédération Wallonie-Bruxelles pour éclairer l'intégration d'une dimension ludique aux pratiques d'enseignement
Lien Teams
Résumé
Cette recherche doctorale, inscrite en sciences de l'information et de la communication, porte sur les pratiques ludiques professionnelles des instituteurs et institutrices primaires qui exercent dans l'enseignement ordinaire (i.e. non spécialisé) sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes années et tous réseaux d'enseignement confondus. Ce sont les pratiques ludiques actuelles qui ont été étudiées dans le cadre de cette recherche : tant les supports analogiques, numériques et hybrides mobilisés par les instituteurs y ont été considérés. Elle poursuit un double objectif : décrire les pratiques ludiques des instituteurs et comprendre ces pratiques. Une méthode découpée en plusieurs phases, inductive et mixte, a ainsi été mise en œuvre. Cette recherche doctorale est toutefois principalement qualitative, les différentes démarches étant au service d'une étude de cas. Lors de cette dernière, neuf enseignants et enseignantes ayant des pratiques ludiques diversifiées ont été suivis, ce durant une année scolaire.
À partir des données recueillies, trois regards ont été croisés sur les pratiques des instituteurs ayant constitué les "cas" : celui que la chercheuse a posé sur leurs pratiques, le leur sur leurs propres pratiques et celui de leurs élèves, à partir de leur vécu en classe. Ces données ont été analysées suivant trois axes, qui structurent le manuscrit : a) "le jeu sur notre terrain", qui vise à répondre aux questions "sur quels éléments la dimension ludique des pratiques d'enseignement repose-elle ?" et "comment cette dimension ludique est-elle perçue par les élèves ?" ; b) "l'introduction du jeu dans les pratiques d'enseignement", centré sur la question "via quelles actions concrètes les instituteurs donnent-ils une dimension ludique à leurs contenus d'enseignement lorsqu'ils les planifient et les mettent en forme ?" ; et c) "l'expérience du jeu en classe", qui vise à répondre aux questions "comment le jeu est-il proposé aux élèves en classe ?" et "quelles relations le jeu induit-il entre les élèves et entre l'enseignant et les élèves ?".
Afin de proposer des pistes de réponse aux besoins exprimés par les participants et participantes à l'étude de cas, ainsi qu'aux freins liés à l'intégration du jeu aux pratiques d'enseignement identifiés sur le terrain, une dernière collecte de données été menée auprès d'acteurs et actrices dits "contextuels". Ces termes désignent des acteurs belges francophones qui travaillent pour et/ou avec des enseignants dont les pratiques professionnelles ont une dimension ludique. Cette démarche, menée dans une perspective d'ouverture, a mis en évidence que, si les instituteurs en sont peu (ou pas) conscients, ils peuvent solliciter une série de personnes-ressources qui gravitent autour d'eux, dans le paysage belge francophone.
Membres du jury
Prof. Thibault Philippette (UCLouvain), promoteur et secrétaire du jury
Prof. Sarah Sepulchre (UCLouvain), présidente du jury
Prof. Vinciane Zabban (Université Paris 13), évaluatrice externe
Prof. Pierre Fastrez (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Benoît Galand (UCLouvain), comité d’accompagnement
Prof. Cédric Heuchenne (UCLouvain), comité d’accompagnement -
 Jéthro Ekoka Bokelo - Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC02 Feb02 Feb...
Jéthro Ekoka Bokelo - Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC02 Feb02 Feb...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Jéthro Ekoka Bokelo
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC »
Lien Teams
Contact: bokelo.ekoka@uclouvain.be
Résumé
Comment les discours publicitaires de la bière ont-ils évolué au cours des années dans la ville de Kinshasa ? Quelles raisons ont motivé la présence de certains discours sociaux dans les publicités de la bière ? Et comment certains sens ou significations le plus souvent conférés à la bière ont-ils émergé et évolué du début de la communication publicitaire jusqu’en 2014 ? Telles sont les questions auxquelles cette étude tente de répondre.
Les textes publicitaires, depuis la première campagne de communication à Kinshasa dans les années 1980 jusqu’en 2014, constituent le corpus étudié. Ce corpus est complété par des données tirées des entretiens avec certains membres des équipes marketing et commerciales de deux principales sociétés brassicoles locales et des agences de publicité en RD Congo qui les accompagnaient ou les accompagnent encore. Nous avons également pris en compte d’autres données scientifiques renseignant sur la culture kinoise et des productions culturelles médiatiques qui reprennent certains faits de société, des thèmes, des figures et des éléments sémiotiques également repérés dans les textes des publicités de bière. Nous nous sommes intéressés à la publicité des bières, car elle est omniprésente en RDC et dans la ville de Kinshasa, où les discours des marques pénètrent le quotidien des Kinois. Le choix des publicités de la bière Primus et la bière Skol, deux bières qui ont accompagné les Congolais dans plusieurs grands évènements de leur histoire, nous a offert la possibilité de remettre ensemble tous les éléments culturels de la RD Congo et a permis une entrée privilégiée dans la compréhension de la culture congolaise.
Les analyses systématiques de textes publicitaires de la bière Primus et la bière Skol nous ont révélé que le bonheur, la réussite de la vie, l’ambiance et le plaisir sont les valeurs principales et les significations basiques des messages que les brasseurs transmettent aux consommateurs de leurs bières. Cependant, ces valeurs basiques ont connu des mutations et des adaptations selon les contextes socioculturels, politiques, économiques et selon les mutations religieuses que le pays a connues. Elles sont abordées dans les publicités des bières en prenant en charge le quotidien des Kinois et se manifestent en mobilisant plusieurs thématiques (du sacré, de la religion, du mode de vie ostentatoire de certains Kinois, de la culture sexuelle congolaise, la polémique ou encore du fétichisme). L’étude a finalement révélé huit générations distinctes dans l’évolution de la publicité de la bière à Kinshasa entre 1980 et 2014.
Cette étude est la première qui propose à la fois un retour historique, une analyse du discours, mais également une lecture socio-sémiotique des productions publicitaires et des stratégies marketing de la bière en RD Congo, en se focalisant sur Bralima et Bracongo (principales brasseries de Kinshasa) en faveur de leur bière phare (la Primus et la Skol). Les résultats de cette étude peuvent enrichir aussi bien les professionnels du secteur de la communication publicitaire que les chercheurs intéressés par les dynamiques sociales réfractées à travers les publicités en RD Congo.
Membres du jury
Professeure Sarah Sépulchre (UCLouvain), Présidente du jury
Professeur Andrea Catellani (UCLouvain), Co-promoteur et secrétaire
Professeur Philippe Marion (UCLouvain), Co-promoteur
Professeur Joël Saucin (IHECS, Bruxelles), Membre
Professeur Fulgence Mungenga Kawanda (UNIKIN), MembreEn savoir plus Jéthro Ekoka Bokelo - Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC02 Feb02 Feb...
Jéthro Ekoka Bokelo - Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC02 Feb02 Feb...Le Recteur de l'Université catholique de Louvain fait savoir que
Mr Jéthro Ekoka Bokelo
soutiendra publiquement sa dissertation pour l'obtention du titre de Docteur en Information et Communication
« Analyse socio-sémiotique des spots, clips et chansons publicitaires de la bière au Congo RDC »
Lien Teams
Contact: bokelo.ekoka@uclouvain.be
Résumé
Comment les discours publicitaires de la bière ont-ils évolué au cours des années dans la ville de Kinshasa ? Quelles raisons ont motivé la présence de certains discours sociaux dans les publicités de la bière ? Et comment certains sens ou significations le plus souvent conférés à la bière ont-ils émergé et évolué du début de la communication publicitaire jusqu’en 2014 ? Telles sont les questions auxquelles cette étude tente de répondre.
Les textes publicitaires, depuis la première campagne de communication à Kinshasa dans les années 1980 jusqu’en 2014, constituent le corpus étudié. Ce corpus est complété par des données tirées des entretiens avec certains membres des équipes marketing et commerciales de deux principales sociétés brassicoles locales et des agences de publicité en RD Congo qui les accompagnaient ou les accompagnent encore. Nous avons également pris en compte d’autres données scientifiques renseignant sur la culture kinoise et des productions culturelles médiatiques qui reprennent certains faits de société, des thèmes, des figures et des éléments sémiotiques également repérés dans les textes des publicités de bière. Nous nous sommes intéressés à la publicité des bières, car elle est omniprésente en RDC et dans la ville de Kinshasa, où les discours des marques pénètrent le quotidien des Kinois. Le choix des publicités de la bière Primus et la bière Skol, deux bières qui ont accompagné les Congolais dans plusieurs grands évènements de leur histoire, nous a offert la possibilité de remettre ensemble tous les éléments culturels de la RD Congo et a permis une entrée privilégiée dans la compréhension de la culture congolaise.
Les analyses systématiques de textes publicitaires de la bière Primus et la bière Skol nous ont révélé que le bonheur, la réussite de la vie, l’ambiance et le plaisir sont les valeurs principales et les significations basiques des messages que les brasseurs transmettent aux consommateurs de leurs bières. Cependant, ces valeurs basiques ont connu des mutations et des adaptations selon les contextes socioculturels, politiques, économiques et selon les mutations religieuses que le pays a connues. Elles sont abordées dans les publicités des bières en prenant en charge le quotidien des Kinois et se manifestent en mobilisant plusieurs thématiques (du sacré, de la religion, du mode de vie ostentatoire de certains Kinois, de la culture sexuelle congolaise, la polémique ou encore du fétichisme). L’étude a finalement révélé huit générations distinctes dans l’évolution de la publicité de la bière à Kinshasa entre 1980 et 2014.
Cette étude est la première qui propose à la fois un retour historique, une analyse du discours, mais également une lecture socio-sémiotique des productions publicitaires et des stratégies marketing de la bière en RD Congo, en se focalisant sur Bralima et Bracongo (principales brasseries de Kinshasa) en faveur de leur bière phare (la Primus et la Skol). Les résultats de cette étude peuvent enrichir aussi bien les professionnels du secteur de la communication publicitaire que les chercheurs intéressés par les dynamiques sociales réfractées à travers les publicités en RD Congo.
Membres du jury
Professeure Sarah Sépulchre (UCLouvain), Présidente du jury
Professeur Andrea Catellani (UCLouvain), Co-promoteur et secrétaire
Professeur Philippe Marion (UCLouvain), Co-promoteur
Professeur Joël Saucin (IHECS, Bruxelles), Membre
Professeur Fulgence Mungenga Kawanda (UNIKIN), Membre
